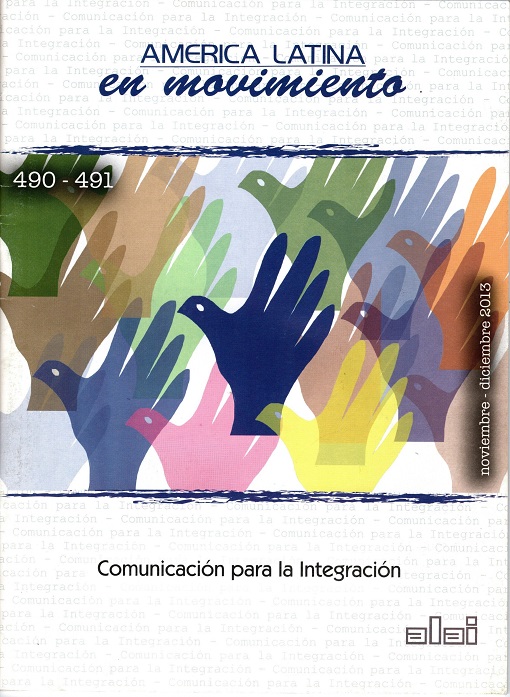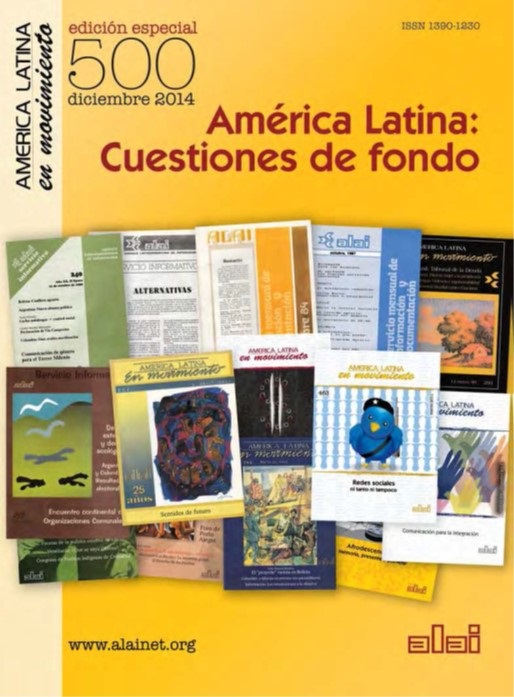Qui a perdu la rue ?
05/03/2015
- Opinión
.jpg)
Un sondage récent d’ICS (International Consulting Services) portant sur les élections législatives de 2015 indique que 43.6% des électeurs voteraient pour le Parti Socialiste Unifié (PSUV) de Nicolas Maduro, l’opposition de droite recueillant près de 32% des intentions de vote (1). Selon des experts comme Oscar Schemel de la firme de sondages Hinterlaces, tout dépendra cependant de l’attitude des «ni-ni» dans le contexte de la guerre économique et des problèmes internes de la politique révolutionnaire. C’est dans ce cadre que Franco Vielma analyse la rue comme espace politique.
Le débat politique national se focalise sur le facteur «rue», parce qu’il reflète la capacité de rassemblement et de mobilisation des forces politiques en présence. C’est de ce thème que sont issus les commentaires de bien des acteurs ou spécialistes de la vie politique, d’Oscar Schémel (président de l’institut de sondages Hinterlaces) à Chuo Torrealba (secrétaire général de la MUD/opposition).
Profitant de la visite d’un quartier de Caracas, ou lors d’événements publics auxquels il participait, Maduro en a également parlé. D’autres encore, en rendront compte, certains l’invoqueront, considérant qu’elle est le passage obligé de tous ceux qui veulent faire la démonstration de leur dynamisme politique, sans oublier la dimension symbolique qu’elle revêt.
Chaussant les souliers confortables d’un élitisme qu’historiquement elle entend incarner, la droite a perdu la «rue» vénézuélienne depuis longtemps. Bien qu’autrefois les «adecos» (adhérents d’Action Démocratique, parti qui a longtemps régné sur le Venezuela) s’en soient proclamés les maîtres, Chavez a forcé la droite à sortir dans la rue, à se confronter au peuple, alors que nombre de ses membres cantonnaient leur action aux médias et aux réseaux sociaux comme unique forme de faire de la politique. Tel était leur unique mode d’engagement politique. Outre la dimension purement électorale, et comme force politique et sociale, le chavisme aura été à tous points de vue, un vecteur de mobilisation permanente. En période révolutionnaire, le chavisme, c’est également l’expression de la mobilisation des foules.
En fait, il est indispensable de prendre en compte la «rue», si l’on souhaite comprendre quelque chose à la politique vénézuelienne, parce qu’elle s’en est emparée, pour ne plus la quitter. Alors, à qui appartient la rue ? est une réflexion qui s’impose à nous, alors que depuis deux ans , les appels à «la sortie» ( = à la démission forcée de Maduro) se sont succédés, deux ans au cours desquels on a cherché à provoquer l’explosion sociale, une sorte de rébellion des classes moyennes (minorité sociologique), par une sorte de stratégie continue de coup d’État.
Ils l’ont perdue et personne ne la leur rendra
La droite vénézuélienne, forte de toutes ses ressources, et de son pouvoir médiatique d’appels à marcher, a eu ses hauts et ses bas de présence dans la rue. Il fut un temps où elle organisait des manifestations éblouissantes qui occupaient tout l’espace autour de l’échangeur routier Altamira, dans l’Est cossu de de Caracas. Elle a également connu -comme en ce moment- le spectre de la démobilisation, dont les déprimantes marches des «casseroles vides» (ou des « esprits vides ») ou les marches des « chemises blanches », ont été les meilleures expressions. Le nombre de dirigeants regroupés sur les estrades était supérieur aux manifestants d’en bas, malgré un thème apparemment « sensibilisateur et mobilisateur » comme l’arrestation de Leopoldo López pour l’organisation de violences mortelles en 2014, et que la droite présente comme « prisonnier politique ».
Durant la période la plus récente, la droite a vu diminuer sa capacité de mobilisation. Chuo Torrealba et Capriles, nouveau et ancien leader de la droite, avaient dit qu’ils annonceraient une série « d’actions de rue pacifiques », des actes politiques qui n’ont pas eu lieu, n’ont pas été annoncés, et les deux seules activités n’ont pas mobilisé.
Qu’est devenu l’appui à la droite dans les rues ? Quels sont les facteurs de démobilisation ? Pourquoi, alors qu’elle représente une force électorale considérable, ses dirigeants n’en sont-ils pas suivis par les gens dans leurs appels à manifester ?
Les égoïsmes et les divisions interdisent à ses dirigeants de se retrouver sur un appel unitaire à manifester. A quoi s’ajoute que dans sa « culture politique », la droite ne voit la rue que comme un facteur conjoncturel, limité au cadre électoral. Hors de ce cadre, l’organisation d’une manifestation perd de son sens. Il y a également le fait que de nombreux manifestants de droite, descendent dans la rue par conviction anti-chaviste mais n’aiment pas les shows personnels, ni ne s’identifient à la démagogie des dirigeants qu’ils associent plutôt à l’erreur et à l’incapacité.
L’opposant moyen est quelqu’un qui exprime son mécontentement, ses rejets, stigmatise son adversaire, se plaint mais rien de plus. Comme la majorité des opposants n’éprouvent pas un grand intérêt pour leur militantisme, leur formation idéologique et l’organisation, il est logique qu’ils n’accordent pas à la «rue», sa valeur réelle, et la considèrent comme une perte de temps. Ils ne l’associent pas non plus aux leaders de la droite, ils ne les voient jamais, ils ne leur attribuent pas le profil de figures poches qui ont les pieds dans la réalité de tous les jours.
Quand la droite appellent à des rassemblements pacifiques, elle n’est pas crédible. Ses partisans savent bien que ces appels débouchent sur des émeutes violentes. L’occupation violente de la rue les ont isolés des autres habitants de la ville, les ont confinés dans une impasse symbolisée par l’appel à la «sortie» à tout prix. Les dirigeants ont tenté de créer un climat de peur parmi leurs propres troupes dans le contexte d’un coup d’État en pointillé, d’un soulèvement militaire avorté, et ce qu’ils ont obtenu fut que la base opposante s’est enfermée chez elle, pas peur de ses propres voisins violents.
Ils ont parlé sans cesse de se retrancher sous la forme d’organes d’«auto-défense» dans les beaux quartiers, pour attendre l’arrivée de «collectifs chavistes sanglants» qui ne sont jamais venus. Ils ont soumis leur propre base a une violence aveugle, bafouant leurs propres droits, et ont ensuite affirmé que les gardes nationaux et les policiers chargés de démonter les barricades- étaient l’ennemi. Dans ces conditions c’était impossible que les habitants des beaux quartiers ne comprennent pas qui étaient les vrais violents. (2)
Une nouvelle relation s’est donc instaurée, entre l’opposition de droite et la « rue », comme réalité subjective. Ceux qui des années durant descendirent dans la rue dans la perspective d’un coup d’État, se confinèrent ensuite à des rassemblements purement politiques. Mais la situation a empiré à tel point que pour nombre d’entre eux, la rue est désormais synonyme d’apathie, d’indifférence. On se méfie d’elle. La majorité des opposants ne croient tout bonnement plus à la violence comme alternative politique.
En fait, la relation symbolique que la droite a nouée avec la rue -qui est d’une nature opposée à celle que le chavisme a impulsée- a connu un tel bouleversement, que la capacité de mobilisation initiale, s’est inversée en démobilisation. La « rue » pour la droite, est un lieu de frustration. Elle a fini par assumer son échec : quinze ans de marches sans jamais atteindre les objectifs qu’elle s’était assignés. Pour elle la rue n’est pas une célébration mais une suite de défaites. Pendant cette même période, le recours intermittent à la violence guarimbera a exprimé l’impuissance de ceux qui croient pouvoir obtenir par la violence ce qu’ils ne peuvent obtenir des urnes ou des rassemblements politiques en tant que tels.
Les dirigeants de l’opposition ont perdu de leur visibilité et se sont désarticulés en appelant à battre le pavé. C’est ce qui est arrivé à Capriles quand il a exhorté à « faire sortir toute la rage » ; à Maria Corina Machado ou à Leopoldo Lopez. Ils ont créé une relation subjective à la « rue » d’un genre particulier qui flirte dangereusement avec le fascisme. Le centre de gravité de la politique de la droite se déplace vers le putschisme, se condamne à l’ostracisme en abandonnant et en démobilisant la majorité de ses troupes, fidèle à la voie électorale.
Le chavisme
Quant au chavisme, il s’est emparé de l’idée collective de la « rue » comme expression d’une identité politique. Il y a un imaginaire particulier qui lui correspond et le le chavisme l’a propulsé avant même de s’appeler chavisme. Le potentiel destructeur de février 1989 (NdT : le « Caracazo », ensemble d’émeutes de la faim réprimées par la social-démocratie soumise au FMI, qui se solda par l’assassinat de 2000 à 3000 personnes), s’est métamorphosé en tension créatrice, en capacité de lutte, de conscience. Le chavisme s’est habitué à marcher loin du cadre électoral, en toutes circonstances, le peuple vénézuelien a eu des luttes à mener et des héritages à défendre.
Le chavisme s’est mobilisé en défense de la révolution et a protesté contre le fonctionnaire corrompu et incapable même s’il se proclamait « chaviste », pour créer des communes, pour des causes ponctuelles, pour s’assumer comme sujet politique collectif vibrant d’une capacité transformatrice.
«Ceux qui sont descendus dans la rue ne s’en iront plus jamais» a dit un jour Chavez au milieu d’une marée humaine. La « rue », c’est le travail, c’est l’effort, c’est le quartier, c’est le village, c’est la communauté, c’est la commune. Ce sont les tâches quotidiennes à accomplir, jour après jour, sans relâche, pour bâtir de nouvelles réalités sociales en période révolutionnaire.
Le 28 février dernier, le président Maduro s’est présenté face à un déferlement rouge dans les rues de Caracas. Tel est l’un de ces paradoxes auquel nous nous accoutumons en période révolutionnaire alors que c’est l’extraordinaire devenant réalité, comme disait le Che. 26 ans après le « Caracazo », les artères de la capitale ont viré au rouge. Mais cette fois-ci, dans un sens totalement différent. Ces rues-là et ces rues-ci, teintées de rouge, sont les mêmes rues : l’héroïsme de ceux-là est le même que l’héroïsme de ceux-ci car ce sont les mêmes qui marchent.
Le chavisme se mobilise, se retrouve, se concentre dans des circonstances difficiles -celles de l’intervention externe, de la guerre économique et du putschisme de l’extrême droite. C’est dans ces moments que nous démontrons de quel bois nous sommes faits. La guerre contre le peuple vise son découragement, à ce qu’il se perde dans les chemins de l’inconscience, de l’amnésie, à nous faire adhérer à la défaite. Mais la sagesse d’un peuple délivre un autre message : nous sommes dans la rue et continuons à défendre la révolution.
Pour savoir qui a perdu la rue, il est nécessaire de savoir qui l’a gagnée. Il faut savoir qui l’a accumulée comme espace constant de lutte. La rue appartient à ceux qui ont dû sortir historiquement pour l’occuper. Les invisibles devenus visibles en la fertilisant de leur propre sueur, de leurs larmes et de leur sang. Celles et ceux qui sous la pluie et le soleil construisons l’élan collectif de la transformation. La rue est notre marque distinctive en politique.
Notes :
(1) Lire « Venezuela Continues to be Chavista, According to New Poll« , http://venezuelanalysis.com/news/11242
(2) La grande majorité des habitants du Venezuela, qui habitent les quartiers populaires, ont rejeté ces violences et ont continué à vaquer à leurs occupations. Sur ce thème voir (entre autres) « Les barrios ne descendent pas » par Eleazar Diaz Rangel http://wp.me/p2ahp2-1mf , « Le Venezuela montre que les révoltes peuvent aussi être une défense des privilèges » par Seumas Milne http://wp.me/p2ahp2-1mf, « La vérité sur le Venezuela : une révolte des classes aisées, pas une « campagne de terreur » (The Guardian, Mark Weisbrot) http://wp.me/p2ahp2-1lk , « Quand tombe le masque de Guy Fawkes de l’opposition vénézuélienne » par Roberto Lovato http://wp.me/p2ahp2-1js, « Coup d’éclairage sur les zones d’ombre médiatiques » par Romain Migushttp://wp.me/p2ahp2-1ec, ou « Brévissime leçon de journalisme pour ceux qui croient encore á l’information » http://wp.me/p2ahp2-1fA . A noter que même dans les quartiers riches, foyers de ces troubles, la majorité des habitants s’opposa à la violence, aux destructions et aux incendies de transports et bâtiments publics , comme en témoigne par exemple le sondage d’Hinterlaces : http://www.hinterlaces.com/graficos/73-de-los-habitantes-en-chacao-rechazan-protestas-violentas. Ramon Muchacho, maire (de droite) d’un de ces quartiers – Chacao -, s’insurgea publiquement contre le vandalisme. : http://www.noticiasdiarias.informe25.com/2014/05/alcalde-chacao-ramon-muchacho-las.html
Traduction : Jean-Marc del Percio
5 mars 2015
URL de cet article : http://wp.me/p2ahp2-1Li
https://www.alainet.org/es/node/167982
Del mismo autor
- Radiografía de un país en asedio 16/05/2018
- MUD llama a "paro cívico" y exige el suicidio de la empresa privada 18/07/2017
- Seis claves sobre el retiro de Venezuela de la OEA 27/04/2017
- ¿Por qué no aplicaron la Carta Democrática contra Venezuela? 02/06/2016
- La contre-offensive bolivarienne et la course contre la montre de la droite au Venezuela 31/05/2016
- Les autres pays qui s’appellent “Venezuela” 29/09/2015
- Los otros países llamados "Venezuela" 29/09/2015
- Qui a perdu la rue ? 05/03/2015
- Quién perdió la calle? 04/03/2015