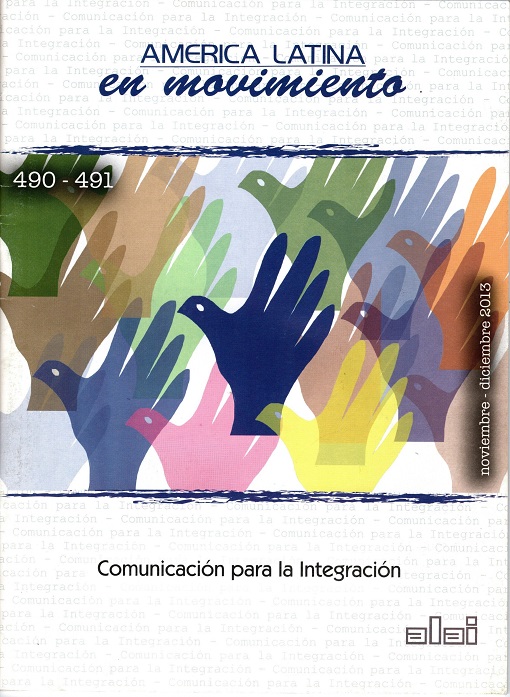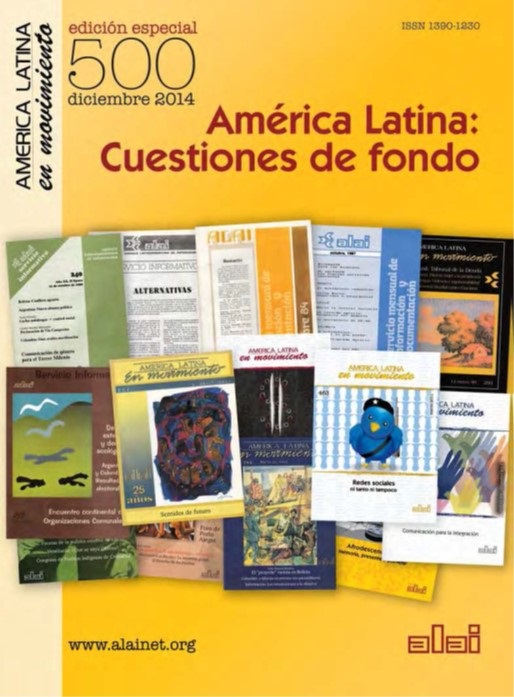Le nouvel imaginaire anti-capitaliste
29/06/2002
- Opinión
Entre la deuxième moitié des années 70 et la fin des années 80 du XXè siècle, la
lutte pour l'hégémonie mondiale a été couronnée par la déroute totale des
concurrents de l'impérialisme euro-américain. Cette déroute a aussi touché les
adversaires radicaux du modèle actuel de pouvoir mondial. Dès lors, une nouvelle
période historique a commencé : d'une part, pour la première fois dans son histoire,
l'espèce humaine dans sa totalité s'est vue encadrée par un seul et unique modèle
de pouvoir. Et d'autre part, la légitimité de ce pouvoir est apparue comme
virtuellement fondée puisque, non seulement les projets alternatifs avaient été mis
en échec, mais, surtout, la critique et ses fondements avaient été exclus du débat
public. Par suite, pour un temps relativement long, le pouvoir a cessé d'être un
sujet de recherche et de débat, si ce n'est de façon technocratique comme une
donnée irréductible de l'existence sociale humaine. Les dominants et les
bénéficiaires de ce nouvel avatar de l'espèce l'ont baptisé, à juste titre,
« globalisation », puisque le « globe » entier était, enfin, sous leur domination
exclusive. Et leur victoire paraissait si complète et définitive qu'ils n'ont pas hésité à
déclarer la « fin de l'histoire » (1).
Le modèle de pouvoir ainsi « globalisé » est le résultat d'un long processus. Il a
commencé en Amérique à la fin du XVè siècle, en réunissant le pouvoir colonial,
comme mode de domination, et le capitalisme, comme système d'exploitation. Il s'est
constitué fondamentalement jusqu'à la fin du XVIIIè siècle, avec pour point culminant
l'eurocentrisme (2). Ses modifications et ses évolutions postérieures ont concerné
avant tout le développement des tendances structurelles déjà définies. Mais de façon
toujours plus hétérogène et discontinue entre les principaux secteurs sociaux en
présence. Ainsi, alors que pour le contrôle des inter-relations sexuelles et subjectives
la crise n'a fait que s'intensifier depuis la fin du XIXè siècle, pour le contrôle du travail
et de l'autorité publique les crises ont pû être résolues contre vents et marées jusqu'à,
précisément, la période de la « globalisation » finale. Plus avant, l'histoire peut être
différente (3).
La « globalisation » de leur modèle de pouvoir a permis aux vainqueurs,
premièrement, d'intensifier leur domination en reconcentrant le contrôle mondial de
l'autorité publique et en bloquant, voire en annulant là où cela a été possible, la
déconcentration ou la nationalisation de la domination. A cet effet, un Bloc Impérial
Global s'est constitué sous l'hégémonie des Etats-Unis. Cette hégémonie a été
brusquement accentuée après le 11 septembre 2002 (4). En d'autres termes,
l'impérialisme a été reconfiguré et intensifié. Deuxièmement, elle a permis
d'accélérer et d'approfondir, pour un temps presque sans résistance, la
reconcentration du contrôle mondial du travail, de ses ressources et de ses produits.
Bref, l'exploitation des travailleurs et la polarisation sociale de la population mondiale
se sont intensifiées.
Dans ces deux dimensions de la « globalisation » du modèle actuel de pouvoir, les
résultats ont été catastrophiques pour la grande majorité de l'espèce. Ainsi, d'un
côté, on constate une augmentation du nombre de pays où l'Etat se dégage de tout
contrôle réel de la majorité de la population et est amené à agir presque
exclusivement comme administrateur et gardien des intérêts des capitalistes
« globaux ». Il s'agit d'un processus de dé-nationalisation de l'Etat et de dé-
démocratisation des relations politiques dans la société. Ce processus touche
principalement les pays où la démocratisation et la nationalisation de la société et de
ses relations avec l'Etat étaient en cours d'élaboration, ou leur conquête encore très
fragile.
De l'autre côté, la reconcentration du contrôle du travail et de ses ressources et
produits et la polarisation sociale de la population mondiale atteignent déjà le point
extrême où 20 % seulement de la population mondiale contrôle 80 % du produit
mondial et où, réciproquement, 80 % de cette population n'a accès qu'à 20 % de ce
produit. Non seulement l'écart entre riches et pauvres de la planète n'a jamais été
aussi grand, mais en plus il s'accroît tous les jours entre les pays, entre les
entreprises et les pays et, bien sûr, entre les habitants de chaque pays. Ainsi, entre
les pays riches et les pays pauvres l'écart est maintenant de 60 à 1 alors qu'il y a
moins de deux siècles, il n'était que de 9 à 1. La General Motors a gagné
168 millions de millions de dollars en 1996 alors que la Bolivie, le Costa Rica,
l'Equateur, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le
Paraguay, le Pérou et l'Uruguay n'ont atteint, tous ensemble, qu'un PIB cumulé de
159 millions de millions de dollars. En Amérique Latine, les revenus des 20 % les
plus riches sont 16 fois plus élevés que ceux des 80 % restants. Aux Etats-Unis, la
population pauvre est passée de presque 25 millions à plus de 35 millions de
personnes au cours des 20 dernières années. Actuellement, les 3 personnes les plus
riches du monde détiennent une fortune supérieure à celle des 48 pays les plus
pauvres (5).
On peut facilement observer que la reconcentration croissante du contrôle mondial de
l'autorité politique, avec toutes ses implications en termes de dé-nationalisation et de
dé-démocratisation des Etats et des sociétés, est le fondement et le mode pour
imposer l'accélération et l'approfondissement de l'exploitation du travail et du
contrôle des ses ressources et de ses produits. Le résultat en est la polarisation de la
population mondiale entre une poignée de capitalistes, individus ou entreprises,
riches, armés jusqu'aux dents, et une écrasante majorité dépouillée de libertés
démocratiques et de moyens de survie.
La « globalisation » du mode actuel de pouvoir produit avant tout ce résultat. Il est
vrai, bien sûr, que la « globalisation » implique aussi l'inter-communication
instantanée, la simultanéité de l'information, la plus grande visibilité de la diversité
des expériences humaines, bref, le changement profond dans nos relations dans
l'espace et dans le temps. Ergo, des modifications profondes des relations inter-
subjectives de la population mondiale qui préludent, peut-être, dans des conditions
historiques différentes, à l'intégration mondiale de l'humanité avec toute la richesse
de sa diversité et de son hétérogénéité d'expériences et de conquêtes historiques.
Personne ne nierait que ces conquêtes de l'innovation scientifico-technologique sont
bien réelles, importantes, décisives pour l'intégration communicationnelle et culturelle
croissante de l'humanité. Mais probablement personne non plus ne discuterait, de
bonne foi du moins, la pertinence d'une interrogation sur la compatibilité de ces
mutations de la vie humaine, dans le cadre de la « globalisation » du modèle actuel
de pouvoir, avec le formidable étau qui enserre la majorité de l'espèce entre, d'un
côté, une structure mondiale d'exploitation et de distribution qui accroît sans cesse
l'extrême concentration du contrôle de la production mondiale, la perte d'emploi et de
revenu des travailleurs et des classes moyennes, la pauvreté absolue de la majorité
et de ce fait la mort quotidienne de centaines de milliers de gens ; et de l'autre côté,
un ordre politique mondial qui globalise l'impérialisme, qui érode l'autonomie,
l'identité et la démocratie de la majorité des pays du « globe » qui prend par là un
caractère conflictuel inhérent dont l'expression est une vague croissante de guerres
et d'échanges entre terrorisme d'Etat et terrorisme privé.
La réponse évidente à cette question est non. Tout au contraire. Cela signifie donc
que les conquêtes technologiques de la civilisation actuelle n'arrivent pas seulement
dans un vide historique, mais bien dans un modèle de pouvoir. Et qu'il ne fait aucun
doute qu'à l'intérieur de ce modèle de pouvoir, elles ne servent pas uniquement à une
plus grande intégration culturelle de l'espèce, mais aussi de support, d'instrument et
de véhicule du développement de la domination et de l'exploitation de la majorité de
la population mondiale.
Les conditions de la résistance
Durant deux décennies, approximativement, cette « globalisation » impériale du
modèle actuel de pouvoir a pû être imposée sans beaucoup, et parfois presque
aucune, résistance. Mais depuis le début de la dernière décennie du XXè siècle, les
travailleurs sont revenus à la lutte ouverte. Tout d'abord dans les pays qualifiés de
« tigres asiatiques » comme la Corée du Sud ou l'Indonésie. Ensuite, dans quelques
pays du « centre », Etats-Unis, France, Allemagne, Italie, en particulier au cours de la
phase de réactivation économique qui a suivi, entre 1994 et 2001, une période de
récession mondiale. Actuellement, la résistance s'étend potentiellement à la totalité
du « globe », tout spécialement parmi les jeunes des pays centraux. Dans le cas de
l'Amérique Latine, aucun pays n'est épargné par les crises politiques et
économiques poussées, dans une large mesure, par les luttes massives de
résistance des exploités, des dominés et des discriminés. Sans la massification et la
« globalisation » de la résistance contre l'impérialisme globalisé, les deux Forums
Sociaux Mondiaux de Porto Alegre, en 2001 et 2002, auraient été impossibles ou
d'une ampleur et d'une résonnance insignifiantes.
Deux questions doivent être posées quand aux conditions et aux caractéristiques de
la résistance contre la « globalisation » impérialiste, parce qu'elles en ouvrent
d'autres sur les conditions et les potentialités de la nouvelle phase du conflit social.
En premier lieu, il faut noter le fait que le temps pendant lequel la « globalisation »
impérialiste a pu s'imposer sans ou presque sans résistance n'a pas été court -
presque trente ans- et qu'elle a commencé sous la forme d'une brusque
reconfiguration de la structure d'accumulation et des relations capital-travail dans les
pays « centraux », de façon plus prononcée d'abord en Angleterre, sous Tatcher, et
ensuite aux Etats-Unis, sous Reagan, durant les années 80 du XXè siècle.
L'explication doit être recherchée dans la convergence, et pas seulement dans la
simultanéité, de deux processus. D'une part, l'érosion et la désintégration finale du
« camp socialiste ». De l'autre, la décision des bourgeoisies « centrales », surtout de
l'association impériale et centenaire britano-américaine, de mettre à profit la
faiblesse de ses concurrents pour lancer une offensive mondiale contre le travail et
contre les bourgeoisies dépendantes afin de reconfigurer, du même coup, la structure
du pouvoir politique mondial, sous l'hégémonie explicite de ladite association, et la
structure d'accumulation mondiale, sous l'hégémonie de son capital financier.
L'affaiblissement du « camp socialiste » jusqu'à l'implosion finale de l'URSS a laissé
sans appui, dans certains cas, et sans référent, dans tous les cas, des régimes qui
jusqu'alors résistaient et même défiaient les pressions impérialistes, tout comme les
organisations et mouvements politiques agissant dans cette période et de ce côté du
conflit, dans le monde entier. C'est ce qui a permis l'intronisation ou la simple
imposition de régimes favorables aux intérêts impérialistes dans la majorité des
pays. Les appels à un « Nouvel Ordre Economique Mondial » de la fin des années 60
et du début des années 70 du XXè siècle, issus de régimes « nationalistes »,
« développementistes » et « réformistes » (6), dont beaucoup étaient liés de
différentes façons et dans différentes mesures au « camp socialiste », ont été
rapidement supprimés et, au cours des années 80, le monde a pris le chemin de ce
que le premier Bush, après la guerre du Golfe, a pu appeler sans vergogne le Nouvel
Ordre Mondial.
Parallèlement et de façon convergente, la crise capitaliste entamée au milieu des
années 70 par la récession, l'inflation, le chômage, et qui a touché les travailleurs du
monde entier, a participé à l'affaiblissement et même à la désintégration des
organisations syndicales des pays « centraux », en les empêchant de résister et de
défendre leurs nombreuses conquêtes antérieures, et, dans la « périphérie », à la
désintégration des identités et des groupements sociaux, à l'érosion incontrôlable
des organisations sociales des travailleurs. « L'ajustement structurel » a été le
résultat de cette convergence entre, d'une part, la déroute politique du « camp
socialiste », des « nationalistes » et des adversaires du modèle même de pouvoir,
et, d'autre part, la crise du capitalisme. Ainsi le développement des tendances
antérieures de dé-concentration ou de re-distribution du pouvoir ont été bloquées et
l'imposition d'une reconcentration mondiale du pouvoir politique impérialiste a été
facilitée, en même temps que la reconcentration mondiale du contrôle capitaliste du
travail et du produit mondial.
La question pertinente est donc comment expliquer la réapparition des travailleurs et
plus généralement des peuples du monde, sans « camp socialiste », sans les
nombreux régimes « nationalistes » et « réformistes », sans projets, ni discours, ni
mouvements ou organisations politiques correspondantes ? Je propose de chercher
les réponses dans deux des situations mentionnées, pour des zones et des
populations différenciées. Dans le « centre », la première impulsion a probablement
été donnée par la relance économique de la fin des années 80 et tout au long des
années 90, particulièrement durant la deuxième moitié de cette décennie, en ce
qu'elle a procuré à des secteurs importants de travailleurs une plus grande sécurité
pour revendiquer à nouveau l'amélioration des salaires et des conditions de travail,
tout comme elle a permis à d'importants segments de la jeunesse d'acquérir le
surplus de conscience et de temps indispensable pour questionner, critiquer,
s'organiser et se mobiliser. Mais à partir de Seattle, c'est la nouvelle conscience
acquise des ravages et de l'avenir funeste de la « globalisation » impérialiste, la
conscience de ce qu'elle ne peut être affrontée qu'en tant que telle, donc
globalement, qui mobilise ces secteurs dans toute l'Europe et aux Etats-Unis (7).
Dans la « périphérie », les premiers à se mobiliser pour résister ont été les
travailleurs des pays surnommés « tigres asiatiques » au moment de la chute brutale,
après une longue période de stabilité sociale, dans le chômage et la pauvreté,
comme en Corée du Sud, ou, comme en Indonésie, d'une brusque crise économique
associée à la crise politique la plus sanglante et corrompue, mais aussi la plus
longue et la plus stable, des régimes despotiques imposés par l'impérialisme. En
Amérique Latine, les mobilisations de résistance n'ont pas, fondamentalement,
d'origines différentes. Si on tient compte notamment des révoltes brésilienne,
argentine, péruvienne à la fin du Fujimorisme, de la révolte mexicaine actuelle au
Chiapas, ou de ce qui se passe au Venezuela depuis le « caracaso », même les
luttes en Bolivie et en Equateur, toutes, de différentes façons selon les particularités
locales, se produisent dans des moments de relative stabilité économique et même
de relative prospérité et de stabilité politique. De toute façon, l'expérience des deux
réunions du Forum Social Mondial à Porto Alegre permet également d'observer que,
une fois la résistance massifiée et globalisée, une nouvelle conscience se forme
rapidement entre les travailleurs et chez les jeunes des classes moyennes en cours
de déstabilisation et de désintégration. Cette nouvelle conscience est actuellement le
nouvel et le plus important élément de motivation et d'impulsion de la mobilisation de
la résistance contre la « globalisation » impérialiste.
Lorsque le premier Forum Social Mondial a été convoqué à Porto Alegre en 2001, le
mouvement de résistance contre la « globalisation » impérialiste était en plein
processus de globalisation. Au total, la présence de presque 20.000 personnes,
jeunes pour la plupart, a largement dépassé les prévisions. Mais la présence de plus
de 50.000 personnes, venant de 150 pays du monde entier, au FSM de 2002, a mis
en évidence le fait que la lutte contre la « globalisation » du modèle actuel de pouvoir
s'était réellement globalisée. Rien ne révèle mieux la reconnaissance de ce fait que
le Forum Economique Mondial de New York qui, quand bien même il a refusé la
confrontation avec le FSM de Porto Alegre, ce qui avait été possible à Davos, a
consacré une grande partie de ses débats formels aux problèmes de la pauvreté et
du chômage.
Qu'est-ce qui explique cette globalisation rapide des mobilisations contre la
« globalisation » impérialiste ? Je suggère que c'est « l'effet de démonstration » des
mobilisations antérieures elles-mêmes qui rend insupportables les effets de la
« globalisation » impérialiste et, en ce sens, le premier FSM de Porto Alegre rempli
assurément un rôle décisif. En d'autres termes, la nouvelle conscience acquise, la
visibilité de l'existence de la résistance mondiale, de la mobilisation d'une population
croissante, de ce que cette mobilisation est non seulement possible mais qu'elle
produit un nouveau « sujet historique » (pour utiliser le vieux jargon) dont l'existence
oblige les dominants à reconnaitre le problème réel de reproduction de la
« globalisation » de leur pouvoir comme le confirment les débats du FEM de New
York. Il est vrai que la situation d'une majorité croissante des peuples du monde se
détériore chaque jour et devient insoutenable. Mais, comme toujours, la pauvreté et la
dégradation des conditions matérielles de vie des peuples ne se transforment en
problème politique, en problème sociétal, que si les victimes s'organisent et se
mobilisent.
De la résistance à l'alternative ? : l'expérience du Forum Social
Mondial de Porto Alegre
Si on examine les discours formels qui ont été au centre des débats du FSM, en
2001 et en 2002, la lutte contre la « globalisation » semble mettre en avant certains
types de problèmes : 1) la défense de l'autonomie des Etats et du contrôle national
des ressources naturelles et en capital, financier en particulier. 2) le rétablissement
de l'emploi, des salaires, des services publics de base dans tous les pays. 3) l'appel
à une lutte globale contre l'extension et l'approfondissement de la pauvreté, par
l'utilisation des revenus du capital financier lui-même. 4) la résistance à la
dégradation croissante de la « nature » et de l'environnement écologique de la
société actuelle. 5) la lutte contre la discrimination de « genre » et de « race ».
Les propositions spécifiques de ces discours, particulièrement au cours du deuxième
FSM de 2002, sont notablement hétérogènes. Sans trop exagérer, on peut dire
qu'elles vont de « l'humanisation » et la « démocratisation » de la « globalisation » et
des institutions de base de l'actuel ordre mondial, le FMI, la Banque Mondiale, l'ONU,
pour affronter la pauvreté et le chômage, jusqu'à la reconquête de l'autonomie
politique des pays, la ré-étatisation des moyens de production et des services
publics et la fin du néolibéralisme, pour rétablir l'emploi, les salaires et les services
publics.
Bref, il s'agirait principalement, soit d'une résistance anti-impérialiste, « anti-
globalisation » dans ce sens spécifique, et contre le néolibéralisme en tant que
modèle universel de politique économique, du refus du caractère prédateur du capital
financier actuel, du rejet des formes de discrimination et de la destruction de
l'environnement écologique -dans ce discours se retrouvent les « anti-impérialistes »
et les « nationalistes », beaucoup des « féministes », des « écologistes » et de ceux
qui s'identifient comme « socialistes », dont la place ici correspond à l'alliance bien
connue entre anti-impérialisme, nationalisme et socialisme autour d'un axe de base :
le contrôle de l'Etat, chacun pour ses propres fins- ; soit d'un accord tacite sur le fait
que les tendances actuelles du pouvoir sont irréversibles et que ce qui a du sens et
peut être obtenu est leur « humanisation » et leur « démocratisation » -on retrouve là,
principalement, les socio-démocrates qui ne s'alignent pas sur la « troisième voie »
de Blair-Schroeder.
On peut en déduire que, dans les discours formels prédominants au Forum, certains
combattent avec la mémoire des conquêtes réalisées, ou proches de l'être, que la
« globalisation » impérialiste et le néolibéralisme détruisent : l'autonomie, la
nationalisation et la démocratisation des Etats et des sociétés, des services publics,
de l'emploi, des revenus. C'est-à-dire la mémoire des conquêtes en termes de
déconcentration et de redistribution de ce modèle même de pouvoir, associée à
l'espérance de sa reconquête. Et que d'autres critiquent les aspects indésirables du
modèle actuel de pouvoir, comme la pauvreté, la violence, la discrimination, la
dégradation écologique, mais, qu'avec l'acceptation tacite de l'irréversibilité de la
« globalisation » de ce pouvoir, cette critique baigne dans une espérance charitable
« d'humanisation » et de « démocratisation ». Il n'y a pas moyen d'établir avec
rigueur où se situe la majorité des participants du FSM respectivement à ces
discours et ces propositions. On peut, au mieux, présumer que les premiers
regroupent plus de gens que les seconds. Mais également, qu'une proportion non
négligeable va et vient entre les deux courants.
Parallèlement cependant, dans les deux réunions du Forum, mais surtout lors de la
plus récente en 2002, une masse imposante de jeunes était présente qui, de plus,
lançait des consignes également très hétérogènes, mais de loin plus radicales, dans
les séminaires, les ateliers, les tables rondes, les réunions informelles, les
campements, les rues et les couloirs du domaine de l'Université Catholique de Porto
Alegre où se sont tenues les deux rencontres du FSM. Le discours de cette jeunesse
venue de tous les coins du monde était dirigé contre le caractère capitaliste, pas
seulement impérialiste, de la « globalisation » et s'orientait vers la lutte contre le
modèle de pouvoir lui-même, dans chaque domaine de base de l'existence sociale,
le travail, le sexe, la subjectivité, l'autorité publique.
L'état d'esprit de cette jeunesse a imprégné tout le Forum et a été, sans doute, ce qui
a conféré à ces réunions, non obstant l'état d'esprit de beaucoup des centaines
d'ONG présentes, un rayonnement puissant et vital, un sens de l'utopie, une
espérance contagieuse en ce que réellement « un autre monde est possible ».
Quel « autre monde est possible » ?
La déroute profonde et prolongée de tous les concurrents de l'impérialisme euro-
américain et des adversaires du capitalisme prend le sens historique d'une contre-
révolution. La « globalisation » impérialiste possède cette caractéristique. En ce
sens précis elle est irréversible : le mode d'existence sociale antérieur ne peut être
rétabli.
En conséquence, tout changement possible qui pourrait être conquis à l'avenir par les
victimes de cette « globalisation » impériale, ne peut être pensé, et donc projeté,
comme une inversion des tendances actuelles du capitalisme, encore moins de ses
effets et implications dans notre histoire, dans notre existence sociale actuelle.
Il est vrai, enfin, que les luttes des dominés/exploités durant 500 ans et en particulier
au cours des 200 derniers, jusqu'à la « globalisation », ont permis, quoique pas
toujours, ni partout, de modérer, de ralentir, de négocier les limites, les conditions, les
modalités de la domination/exploitation. Par conséquent, il est non seulement
nécessaire et urgent d'essayer d'obtenir d'imposer de nouveau ces conditions pour
améliorer la situation et les perspectives des travailleurs à l'intérieur du modèle actuel
de pouvoir, mais il est aussi, en principe, possible d'obtenir ces changements sans,
nécessairement, détruire ce modèle de pouvoir en tant que tel.
Cependant, la question qui doit être creusée et résolue est de savoir si de tels
changements sont réllement viables, étant donné le niveau et l'échelle déjà atteints
par les tendances du capitalisme et du modèle fort de pouvoir qu'il utilise. Le
capitalisme compétitif permettait, et même requérait, en un sens, une démocratie
spécifique, même si son exercice a été conquis ou admis principalement au
« centre ». Le capitalisme monopolistique a déjà produit des tendances vers la
réduction de cet horizon, mais l'extension universelle d'une structure productive
associée à la relation capital-salaire a permis que les luttes pour la démocratie
spécifique de ce pouvoir soient également viables dans la « périphérie », et la sur-
exploitation du travail dans cette « périphérie » a donné à la bourgeoisie du
« centre » les moyens de concéder « l'Etat providence » aux luttes de ses travailleurs
locaux. Mais le capitalisme impérialiste « globalisé » développe des tendances qui
bloquent et pervertissent toujours plus cet horizon. La technocratisation et
l'instrumentalisation de sa rationalité, le caractère prédateur de l'accumulation
spéculative, la perte de capacité et d'intérêt de la commercialisation de la force de
travail vivante et individuelle, qui amène à la réduction de l'emploi salarié stable,
toutes ces tendances sont structurellement associées à la concentration de la
richesse et des revenus, à la polarisation corrélative inter-étatique et sociale, et ainsi
à la nécessité d'une concentration croissante du contrôle de l'autorité publique.
Dans de telles conditions, de quelle ampleur et de quelle profondeur est ou peut être
la marge pour la déconcentration stable et pour une redistribution relativement
importante du pouvoir que toute démocratie, nécessairement, implique ? Le monde
dominé « globalement » par ce modèle de pouvoir est, il est vrai, hétérogène,
structurellement et historiquement, raison pour laquelle le modèle de pouvoir lui-
même est hétérogène et discontinu. Il est donc toujours possible que, dans une ou
quelques unes de ses sphères, ce pouvoir soit forcé d'admettre un peu de sa
démocratie spécifique. Cependant, ce qui est improbable, c'est que le modèle de
pouvoir lui-même, en tant que tel, soit modifié de façon généralisée ou universelle,
qu'il se convertisse en un pouvoir démocratique, même dans les limites spécifiques
de sa démocratie, qu'il soit « démocratisé » et « humanisé » sans perdre son
caractère propre, c'est-à-dire sans être détruit.
Dans cette perspective, la nostalgie, qui implique une certaine mystification de la
perte due à la « globalisation » impérialiste, ne peut constituer l'espoir des luttes qui
ont recommencé. Et, d'un autre côté, la déroute qui a permis que toutes les
conquêtes ou presque nous soient enlevées, ne pourrait être expliquée sans relation
avec le caractère même qu'avaient ces conquêtes et leurs luttes respectives. Et ceci
est, sans doute, ce que pressentent les jeunes du monde, précisément parce qu'ils
sont le produit de cette « globalisation ».
Ceux qui se sont formés dans cette « globalisation » et qui sont majoritaires dans les
pays pauvres, ont besoin et demandent, comme toutes les victimes de ce pouvoir, un
accès égal aux biens et aux services, de tous ordres, qui sont produits dans le monde
actuel. Il ne s'agit pas seulement d'objets ou de services, mais aussi de modes de
relation sociale égalitaire dans chaque sphère de l'existence sociale, du travail et de
ses produits, du sexe et de ses produits, de la subjectivité et de ses produits, de
l'autorité publique et de ses produits. Et ils se les procureront de quelque façon que
ce soit. Si c'est possible par les moyens qui continuent de constituer la promesse
libérale, bien (8). Si ce n'est pas possible, alors il l'attaqueront. Ils ont déjà
commencé.
La colonialité du pouvoir et la question de la démocratie
aujourd'hui
Le modèle actuel de pouvoir « globalisé » se fonde sur deux axes centraux : l'un est
un système basique de domination qui organise toutes les formes antérieures autour
de la classification universelle de base des personnes selon le critère de la « race » ;
l'autre est un système basique d'exploitation qui organise toutes les formes de
contrôle du travail autour du capital. Les deux axes sont réciproquement dépendants.
Leur union pour former un modèle de pouvoir spécifique est le résultat de
l'expérience coloniale commencée avec l'Amérique. La colonialité est, en cela, la
condition fondatrice et inhérente de ce modèle de pouvoir. La colonialité ne se réfère
pas seulement à la classification « raciale » de la population du monde. Sans elle, et
dans une perspective de globalité, aucun des lieux de pouvoir, le contrôle du travail,
de ses ressources et de ses produits ; le contrôle du sexe, de ses ressources et de
ses produits ; le contrôle de la subjectivité, de ses ressources et de ses produits ; ou
le contrôle de l'autorité publique ou collective, de ses ressources et de ses produits,
n'auraient ses caractères spécifiques actuels. La dénomination exacte de ce modèle
de pouvoir serait celle de colonial-capitaliste (9).
Du fait de ce caractère constitutif, à l'égard de la démocratie le modèle actuel de
pouvoir est, sans doute, le plus contradictoire de tous les modèles connus. En effet,
d'une part il implique une condition radicalement antagonique à la démocratie : la
colonialité du pouvoir ; mais, d'autre part, par les conditions historiques du processus
du capital en tant que relation sociale et de sa centralité dans le système
d'exploitation, il a eu besoin d'un mode et d'un degré de relations démocratiques,
particulièrement dans certaines instances du pouvoir, l'autorité publique et la
subjectivité. La dialectique historique complexe entre les deux termes de cette
contradiction a été présente dans la distribution géoculturelle hétérogène et
discontinue de l'expérience de la démocratie dans le monde des 500 dernières
années, notamment si on considère les relations entre l'Europe et le non-européen au
sujet de l'Etat-Nation et de la sécularisation des relations intersubjectives (10).
De toute façon, la démocratie est l'un des biens qui, dans ce modèle de pouvoir, est
arrivé à être exceptionnellement coté, jusqu'à être finalement intégré comme une
nécessité vitale de l'imaginaire universel. C'est pour cela qu'à son sujet se pose
aujourd'hui un double problème pour ce modèle de pouvoir. En premier lieu, c'est sa
« globalisation », précisément, qui a universalisé ce bien dans l'imaginaire mondial
et l'a, simultanément, mis dans un contexte de risque majeur pour sa survie. En
second lieu, pour l'accès à tous les autres biens et services que le monde produit, la
démocratie est aujourd'hui littéralement indispensable. Sur ces deux plans, d'autant
plus quand les tendances « globalisantes » du capitalisme se développent
davantage.
La démocratie a toujours été un bien rare et accéder à son usage et à son exercice a
toujours été très coûteux, subjectivement et matériellement. Et la colonialité du
modèle actuel de pouvoir est devenue l'obstacle majeur, y compris pour l'exercice
limité que ce pouvoir admet. Non seulement le pouvoir actuel maintient sa rareté,
mais il lui fait courrir un risque définitif. Ce qui a été l'une des conquêtes de la
modernité entamée avec l'Amérique, est aujourd'hui traquée, dans la dimension
subjective de notre existence sociale, par les fondamentalismes de tous ordres,
certains des plus influents d'entre eux produits et cultivés dans le « centre » même du
capitalisme, et dont l'agressivité et la violence sont alimentées précisément par la
crise de ce pouvoir et de sa « globalisation ». Et, dans la dimension matérielle, elle
est violemment bousculée par les intérêts sociaux les plus prédateurs du capitalisme
actuel.
Tout cela précisément alors qu'il est plus nettement perceptible que jamais, pour tout
le monde, mais avant tout pour les jeunes, que la démocratie est aujourd'hui la
condition de base d'une égalité d'accès aux principaux biens et services que
l'humanité produit. Et cela constitue certainement l'apprentissage central de la
jeunesse formée dans la « globalisation » impérialiste. Pour commencer, parce que
la simultanéité de l'information et de la communication implique l'accès imaginaire à
tous les biens, à tous les services, à la multiplicité d'options de l'expérience diverse
et hétérogène de l'espèce, qui circulent sur les autoroutes de la « société virtuelle ».
Par contraste avec cet étalage, la globalisation des tendances actuelles du
capitalisme polarise jusqu'à l'extrême les possibilités sociales, y compris
géoculturelles, d'accès aux biens et aux services les plus désirés ou les plus
nécessaires exposés à la convoitise des gens, des jeunes en particulier. Le modèle
de pouvoir qui produit et impose une telle polarisation devient donc toujours plus
insupportable. Il devrait être changé. Et si l'expérience récurrente montre qu'il ne peut
être modéré et « humanisé », il doit être détruit.
Principalement depuis la fin du XIXè siècle, des courants d'idées et des
organisations politiques qui préconisaient que la démocratie était la condition même
du développement de la société humaine, étaient déjà actifs. Mais les tendances
critiques du capitalisme qui sont devenues majoritaires, ont opté pour la
concentration du contrôle de l'état-nation et du contrôle étatique de la propriété des
moyens de production et des produits parce que, surtout en ce qui concerne la
tendance dite du « matérialisme historique » et plus tard du « marxisme-léninisme »
devenue mondialement hégémonique dans le mouvement révolutionnaire, c'était le
chemin le plus réaliste, « non utopique », pour sortir du capitalisme.
L'expérience de plus de 70 ans de « socialisme réel » et la déroute et la
désintégration finale du « socialisme réel » ont montré, cependant et sans ambages,
que par ce chemin une société alternative à celle du capitalisme n'était pas viable,
précisément parce qu'il était incompatible avec l'approfondissement continu de
relations démocratiques dans la vie quotidienne des gens. Que, par conséquent,
seule la destruction du pouvoir, de tout pouvoir, pas de sa simple concentration,
représentait le véritable chemin. La « globalisation » impérialiste du capital
monopolistique financier qui a suivit, n'a fait que confirmer cette expérience.
Dans ce sens, l'expérience du XXè siècle laisse quelques leçons claires pour les
gens formés durant cette « globalisation », depuis le milieu des années 70 :
1. Le développement de moyens scientifiques et technologiques produits à
l'intérieur du modèle actuel de pouvoir a augmenté la capacité productive de
l'espèce et par là sa capacité de développement propre ; il a amplifié et il amplifie
constamment la circulation et l'échange mondial de la diversité et de
l'hétérogénéité d'expériences de l'espèce et par là également les marges de
liberté individuelle et d'égalité sociale.
2. Mais par son caractère colonial-capitaliste, le pouvoir actuel se globalise en
développant des tendances qui tournent toujours plus en faveur de ses éléments
les plus anti-démocratiques, et ainsi rétrécit et pervertit constamment les
conquêtes démocratiques antérieures et bloque le potentiel démocratique des
puissants moyens technologiques, tant en termes de capacité productive qu'en
termes de marges d'égalité et de liberté individuelle et sociale.
3. Par conséquent, la démocratie est maintenant la condition indispensable non
seulement à l'égalité d'accès aux ressources, biens et services produits par
l'espèce, mais aussi au développement même des potentialités inhérentes aux
moyens scientifico-technologiques actuels et donc à la recherche et au
développement de nouveaux sens historiques de la vie de l'espèce, de nouveaux
horizons de sens historique.
4. L'expérience du « camp socialiste » s'est révélée inappropriée pour la production
d'une existence sociale alternative à celle du modèle actuel de pouvoir. Sa
détermination de base a été la concentration de pouvoir qui s'est installée depuis
le départ, en expropriant la socialisation du pouvoir entreprise par les travailleurs.
Autrement dit, le remplacement de la démocratie des producteurs par le
despotisme bureaucratique.
5. La démocratie alternative qui a pu être conquise dans certaines zones du
capitalisme, est à la fois un approfondissement et une rupture de cette
expérience. Dans ce sens, elle se projette comme un élargissement et un
approfondissement continus de l'égalité sociale de gens divers et hétérogènes,
de la liberté individuelle et de la solidarité collective entre eux.
En conséquence, le nouvel imaginaire historique qui est en cours de constitution,
avant tout parmi les jeunes, s'élabore contre le modèle de pouvoir colonial-capitaliste
et sa « globalisation » impérialiste, et dans le même temps contre le despotisme
bureaucratique. Pour cela, ce nouvel imaginaire a deux éléments constitutifs
principaux : premièrement, la nécessité et la recherche d'un nouvel horizon de sens
de l'existence sociale de l'espèce, comme élément fondateur de toute existence
sociale alternative. C'est ce qui émerge comme contenu de l'idée d'utopie
révolutionnaire. Deuxièmement, la démocratie comme condition, point de départ et
axe de toute trajectoire de production d'une autre société, d'une existence sociale
alternative à celle imposée par le modèle colonial-capitaliste de pouvoir.
Il est peut-être vrai, comme le signale Habermas à regret et avec lucidité (11) qu'il
n'existe aucune garantie de ce que les expériences et l'apprentissage réalisés au
cours de l'histoire d'une société et d'un modèle de pouvoir spécifiques soient de
nouveaux points de départ qui permettent d'éviter la répétition des mêmes erreurs
quand on entre dans une autre histoire, c'est-à-dire dans une nouvelle société. C'est
une des tragédies historiques de l'espèce, la seule à tomber deux fois dans le même
piège. Mais c'est aussi un trait définitif de sa liberté, de son aptitude et de sa
disposition à repenser, à choisir et à décider de nouveau, autant de fois qu'il le sera
possible ou nécessaire.
Quoi qu'il en soit, cette nouvelle perspective pourra, à l'avenir, donner sens au débat
sur les questions relatives au pouvoir et à la révolution.
1) Mon point de vue sur la « fin de l'histoire » in ¿El Fin de cual Historia? in Análisis
Político, Revue de l'Institut d'Etudes Internationales, Université Nationale de
Colombie, n° 32, septembre-décembre 1997, Bogota, Colombie.
2) J'ai proposé cette perspective théorique principalement in Colonialidad del
Poder, Eurocentrismo y América Latina, in Edgardo Lander, ed. Colonialidad
del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales. UNESCO-CLACSO, 2000,
Buenos-Aires, Argentine.
3) Différentes propositions de débat in El trabajo en el Umbral del Siglo XXI,
Confédération Générale des Travailleurs de Puerto Rico et Centre d'Etudes du
Travail, San Juan, Puerto Rico, 1998.
4) Autour de ces questions, je renvois à mon étude Globalización, Colonialidad y
Democracia. In Tendencias Básicas de Nuestra Epoca: Globalización y
Democracia, Institut des Hautes Etudes Diplomatiques Pedro Gual, 2001,
Caracas, Venezuela, pp. 25-61. Et in Trayectorias, Revue de Sciences Sociales
de l'Université Autonome de Nuevo León, 4ème année, n° 7-8, septembre 2001,
Monterrey, Mexique, pp. 58-91. Pour leur part, Michael Hardt et Tony Negri,
Empire (Harvard University Press, 2000), soutiennent que nous sommes déjà
dans un Empire analogue à l'empire romain.
5) Voir, de l'auteur, Globalización, Colonialidad y Democracia, op. cit.
6) Dans le cas de l'Amérique Latine, il suffit de rappeler qu'à la fin des années 60 /
début des années 70 du XXè siècle, la Démocratie Chrétienne était présente au
Chili, menée par Frei, et que l'Unité Populaire lui a succédé avec Allende ; les
militarismes « nationalistes » au Pérou et en Bolivie ; les démo-nationalistes
comme l'Action Démocratique de ces années au Venezuela ; les libéraux
développementistes en Colombie, en Argentine, en Uruguay et même la dictature
militaire au Brésil pratiquaient une politique de développement et
d'industrialisation. Au Mexique, le contrôle de l'Etat par le PRI était encore très
ferme. Ces régimes ont agi, à cette époque, plus ou moins en convergence avec
le Nasserisme et le Baathisme du Moyen Orient, avec certains régimes post-
coloniaux africains qui se réclamaient du « socialisme africain », ainsi qu'avec
ceux du Sud-Est asiatique qui avaient alors une analogie d'orientation et qui,
ensemble, faisaient en sorte d'avoir un certain poids sur l'échiquier politique et
économique mondial et qui s'appuyaient sur le « camp socialiste » qui paraissait
encore très fort malgré le différent sino-russe ou qui pouvaient s'en servir comme
référence dans le bras de force avec l'impérialisme euro-américain. Le
mouvement des Non-Alignés, le Groupe des 77, le Pacte Andin en défense du
marché régional, sont tous issus de ce mouvement mondial de lutte pour la
déconcentration de l'autorité politique mondiale et pour une redistribution réelle du
contrôle du travail et de ses produits. Tous ont été défaits avec la crise mondiale
du capitalisme et l'avènement du Tatcherisme-Reaganisme en tant que stade
majeur de la coalition impérialiste britano-américaine qui trouve son origine vers
la fin du XIXè siècle et qui s'affirme jusqu'à nos jours comme la coalition
hégémonique du Bloc Impérial Global.
7) Voir sur cette question, par exemple, Jay Mansour : The Labor's New
Internationalism, in Foreign Affairs, Janvier/Février 2000.
8) Rien ne peut être plus pathétique, ou plus hypocrite, que le discours des acteurs
de la « globalisation » néolibérale : ils proclament d'une voix prétentieuse la lutte
frontale contre la pauvreté, alors qu'ils font tout pour produire plus de pauvres et
plus de pauvreté.
9) Voir Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina, op. cit.
10) Débat plus large sur ces questions in Estado-Nación, ciudadanía y Democracia:
Cuestiones Abiertas ; in Helmut Schmidt et H. Gonzáles, comps. Democracia
para una Nueva Sociedad, Nueva Sociedad1998, Caracas, Venezuela ; in El
Retorno del Futuro y las Cuestiones del Conocimiento ; in Hueso Húmero, n°
37, Lima, Pérou.
11) Jurgen Habermas : The Theory of Communicative Action, Beacon Press, 1984,
Boston, Mass., USA, vol. II, Part. V.
*Aníbal Quijano, sociologue péruvien, est professeur dans de nombreuses
universités, au Pérou et ailleurs, et auteur de multiples publications.
Traduit de l'espagnol par ALAI.
https://www.alainet.org/es/node/108195
Del mismo autor
- De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder 18/12/2020
- ¿Un Nuevo Comienzo? 26/02/2009
- Otro horizonte de sentido histórico 25/02/2009
- Des/colonialidad del poder: el horizonte alternativo 16/05/2008
- Emergência no Haiti 12/04/2008
- Emergencia en Haití 09/04/2008
- De la resistencia a la alternativa 29/10/2007
- Allende otra vez: En el umbral de un nuevo periodo histórico 15/09/2003
- Le nouvel imaginaire anti-capitaliste 29/06/2002
- El nuevo imaginario anticapitalista 08/04/2002