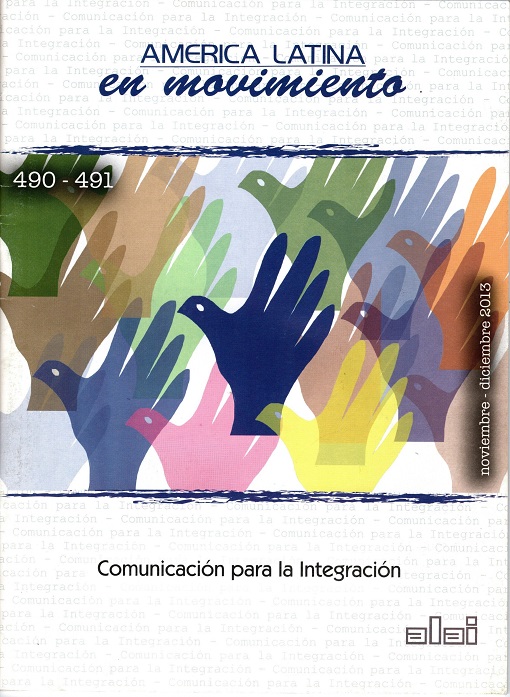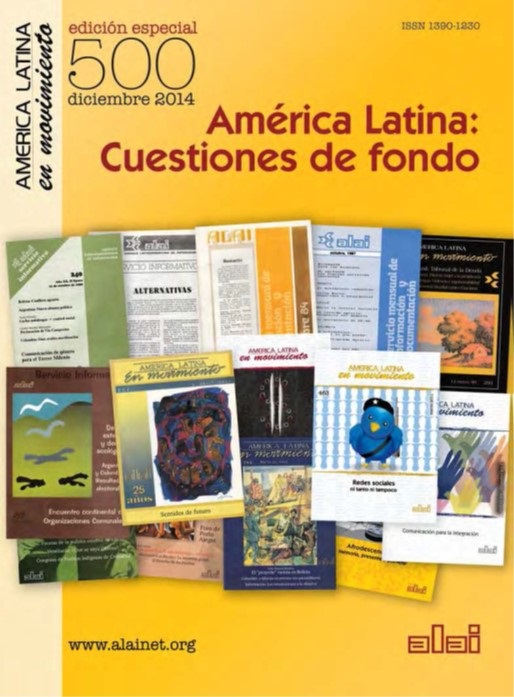« Techno-féodalisme, critique de l’économie numérique »
Nous vivons dans une féodalité typique des temps modernes, très éloignée de la liberté et de l’équité promise par les nouvelles technologies, affirme cet économiste.
- Opinión

Depuis Paris. Tout le monde les attendait et les souhaitaient tel un Messie. Et pour finir un monstre est apparu. En réalité, nous vivons dans une féodalité typique des temps modernes, très éloignée de la liberté et de l’équité promise par les nouvelles technologies. Sous couvert d’une rhétorique du progrès et de l’innovation, se cache le fouet le plus dur et le plus ancien de domination. Les nouvelles technologies sont tout le contraire de ce qu’elles promettent. Telle est la thèse d’un brillant essai publié par le chercheur Cédric Durand : « Technoféodalisme : Critique de l’économie numérique ». Durand démontre comment, contrairement à ce qui circule dans les médias, avec les nouvelles technologies, au lieu de se civiliser, le capitalisme s’est renouvelé en reculant.
Il fut installé au Moyen Âge avec les outils de la modernité. Il n’a ni fait, ni ne nous a fait faire un saut vers le futur, mais il s’est replié et a ainsi ressuscité les formes les plus cruelles de domination et de soumission. Le mythe de la Silicon Valley fond comme neige au soleil devant nous : l’accumulation scandaleuse de profits, les techno-dictateurs, les inégalités sociales inconvenantes, le chômage chronique, des millions de pauvres supplémentaires et une poignée de techno-oligarques qui ont accumulé des fortunes inégalées. La, si en vogue, « nouvelle économie » a donné naissance à une économie de domination et d’inégalité. La thèse du livre de Cédric Duran est un voyage à l’envers, une déconstruction des mythes technologiques : la numérisation du monde n’a pas conduit au progrès humain mais à une gigantesque régression dans tous les domaines : restauration des monopoles, dépendance, manipulation politique, privilèges et une action de prédation mondiale sont la véritable identité de la nouvelle économie.
Economiste, professeur à la Sorbonne, Durand est un spécialiste de l’organisation de l’économie mondiale et des dynamiques du capitalisme : multinationales, délocalisations, mondialisation, chaînes de production mondiales. Avec cet essai, son analyse fait irruption sur le terrain d’un mythe technologique qui nous consume et qui nous formate chaque jour. Comme le montre cette interview faite à Paris, le mythe de la nouvelle économie est à court d’ailes pour continuer à voler. Son vrai visage est ici.
Enveloppés de mythes, de manipulations, d’égoïsme et de rêves de progrès humain, quels sont les véritables ressorts de l’économie numérique ?
![]() Elle a plusieurs dimensions. Il y a d’abord ce qu’on a appelé « la nouvelle économie numérique » dont l’idée générale était que de nouvelles règles seraient appliquées au fonctionnement de l’économie grâce à la poussée des technologies de l’information et de la communication. À partir de 1990, cette idée accompagne le renouveau du néolibéralisme : l’innovation, l’esprit d’entreprise et la protection de la propriété intellectuelle en sont les idées porteuses. Il a été dit que grâce aux technologies de l’information et de la communication ainsi qu’à l’ensemble de la sphère numérique, il y aurait nombre de couts qui s’annuleraient et qu’une nouvelle ère de prospérité émergerait. Cela fut tout le contraire.
Elle a plusieurs dimensions. Il y a d’abord ce qu’on a appelé « la nouvelle économie numérique » dont l’idée générale était que de nouvelles règles seraient appliquées au fonctionnement de l’économie grâce à la poussée des technologies de l’information et de la communication. À partir de 1990, cette idée accompagne le renouveau du néolibéralisme : l’innovation, l’esprit d’entreprise et la protection de la propriété intellectuelle en sont les idées porteuses. Il a été dit que grâce aux technologies de l’information et de la communication ainsi qu’à l’ensemble de la sphère numérique, il y aurait nombre de couts qui s’annuleraient et qu’une nouvelle ère de prospérité émergerait. Cela fut tout le contraire.
En réalité, cela fut un conte qui a gelé la prospérité collective.
![]() Je reconnais, bien sûr, qu’avec l’apparition des médias numériques, il y a eu quelque chose de nouveau qui a germé, mais, surtout, ce que j’essaie de démontrer, c’est que, contrairement à ce qui a été annoncé, nous n’avons pas vu un horizon radieux du capitalisme, mais bien au contraire, c’est-à-dire une dégradation du capitalisme. L’économie politique numérique consiste à admettre à la fois le saut technologique et les changements institutionnels qui l’ont accompagné,ce qui se résume principalement en un seul : le durcissement du néolibéralisme. Le résultat de tout cela est que nous n’avons pas assisté à une nouvelle prospérité d’un capitalisme fougueux, mais bien au contraire, à savoir à un capitalisme en voie de régression.
Je reconnais, bien sûr, qu’avec l’apparition des médias numériques, il y a eu quelque chose de nouveau qui a germé, mais, surtout, ce que j’essaie de démontrer, c’est que, contrairement à ce qui a été annoncé, nous n’avons pas vu un horizon radieux du capitalisme, mais bien au contraire, c’est-à-dire une dégradation du capitalisme. L’économie politique numérique consiste à admettre à la fois le saut technologique et les changements institutionnels qui l’ont accompagné,ce qui se résume principalement en un seul : le durcissement du néolibéralisme. Le résultat de tout cela est que nous n’avons pas assisté à une nouvelle prospérité d’un capitalisme fougueux, mais bien au contraire, à savoir à un capitalisme en voie de régression.
Une autre des perversions cachées de cette nouvelle économie est l’augmentation des injustices dans les relations sociales et, par conséquent, un changement de perspective de ces relations. Vous avez défini les deux tendances comme l’instauration d’un « techno-féodalisme », d’une économie numérique féodale.
![]() Oui effectivement. Dans mon livre, je montre que l’enjeu de l’économie numérique est une reconfiguration des relations sociales. Cette reconfiguration se manifeste par la résurgence de la figure de la dépendance, qui était une figure centrale du monde féodal. L’idée de dépendance renvoie au principe selon lequel il existe une forme d’adhésion de l’être humain à une ressource. Au sein du marché, il y a eu une monopolisation, par le capitalisme, des moyens de production, mais ces moyens ont été pluriels. Les ouvriers devaient trouver du travail et, d’une certaine manière, pouvaient choisir le travail. Il y avait une forme de circulation qui donnait lieu à la concurrence. Dans cette économie numérique, dans ce techno-féodalisme, les individus mais aussi les entreprises adhèrent à des plateformes numériques qui centralisent une série d’éléments qui leur sont essentiels pour exister économiquement dans la société contemporaine. Il s’agit du Big Data, des bases de données, des algorithmes qui permettent leur traitement.
Oui effectivement. Dans mon livre, je montre que l’enjeu de l’économie numérique est une reconfiguration des relations sociales. Cette reconfiguration se manifeste par la résurgence de la figure de la dépendance, qui était une figure centrale du monde féodal. L’idée de dépendance renvoie au principe selon lequel il existe une forme d’adhésion de l’être humain à une ressource. Au sein du marché, il y a eu une monopolisation, par le capitalisme, des moyens de production, mais ces moyens ont été pluriels. Les ouvriers devaient trouver du travail et, d’une certaine manière, pouvaient choisir le travail. Il y avait une forme de circulation qui donnait lieu à la concurrence. Dans cette économie numérique, dans ce techno-féodalisme, les individus mais aussi les entreprises adhèrent à des plateformes numériques qui centralisent une série d’éléments qui leur sont essentiels pour exister économiquement dans la société contemporaine. Il s’agit du Big Data, des bases de données, des algorithmes qui permettent leur traitement.
Nous sommes ici confrontés à un processus d’auto-renforcement : plus nous participons à la vie de ces plateformes, plus elles offrent de services essentiels, plus la dépendance augmente. Cette situation est très importante car elle tue l’idée de concurrence. Cette domination lie les individus à cette transplantation numérique. Ce type de relation de dépendance a une conséquence : la stratégie des plateformes qui contrôlent ces territoires numériques est une stratégie de développement économique par prédation, par la conquête. Il s’agit de conquérir davantage de données et d’espaces numériques. Et acquérir de plus en plus d’espaces numériques signifie accéder à de nouvelles sources de données. Nous entrons ici dans une sorte de compétition où, contrairement à avant, le but n’est pas de produire plus efficacement, mais plutôt de conquérir plus d’espaces. Ce type de conquête s’apparente à la féodalité, c’est-à-dire à la compétition entre seigneurs, qui ne s’est pas manifestée par l’amélioration des conditions mais par une lutte pour la conquête. Les deux éléments, à savoir la dépendance et la conquête de territoires, nous rapprochent de la logique du féodalisme.
C’est une logique mise à jour grâce à des supports ultra modernes : algorithmes et prédation féodale.
![]() Effectivement. Le point décisif de l’économie numérique est qu’elle évolue lentement. Contrairement à la logique productive typique du capitalisme, où les capitalistes étaient obligés d’investir pour faire face à la concurrence, ici, dans l’économie numérique, paradoxalement, en s’appuyant sur la logique de la prédation ,est menée une sorte d’innovation très orientée vers la conquête de la donnée et non vers une production efficace. La stagnation qui caractérise le capitalisme contemporain, c’est-à-dire le chômage endémique, la baisse de la croissance, les mauvais salaires, bref, tous ces échecs économiques sont associés à un comportement où la prédation se superpose à la production.
Effectivement. Le point décisif de l’économie numérique est qu’elle évolue lentement. Contrairement à la logique productive typique du capitalisme, où les capitalistes étaient obligés d’investir pour faire face à la concurrence, ici, dans l’économie numérique, paradoxalement, en s’appuyant sur la logique de la prédation ,est menée une sorte d’innovation très orientée vers la conquête de la donnée et non vers une production efficace. La stagnation qui caractérise le capitalisme contemporain, c’est-à-dire le chômage endémique, la baisse de la croissance, les mauvais salaires, bref, tous ces échecs économiques sont associés à un comportement où la prédation se superpose à la production.
Vous vous moquez de l’idée véhiculée dans les médias selon laquelle l’économie numérique est l’expression la plus complète d’une économie civilisée. Bien au contraire, c’est un brutal pas en arrière.
![]() On assiste à une régression, un recul socio-économique. Au lieu de passer à une forme plus civilisée, plus élaborée, plus appropriée au bonheur humain, les moyens numériques nous amènent à revenir à des formes archaïques que nous croyions remplacées par la modernité.
On assiste à une régression, un recul socio-économique. Au lieu de passer à une forme plus civilisée, plus élaborée, plus appropriée au bonheur humain, les moyens numériques nous amènent à revenir à des formes archaïques que nous croyions remplacées par la modernité.
Dans votre travail, vous indiquez que le remplacement qui a été produit pour que cet archaïsme domine tout : cette économie numérique a remplacé le Consensus de Washington par ce que vous appelez le consensus de la Silicon Valley. Cependant, ce remplacement n’a rien changé car il fonctionne selon les mêmes exigences : réformes, travail précaire, marché, financiarisation de l’économie. Comme avant !
![]() Le consensus de la Silicon Valley ajoute une couche supplémentaire au consensus de Washington. La grande justification du consensus de Washington était de dire que la planification ne fonctionnait plus parce que l’Union soviétique avait échoué. Par conséquent, il faut libérer les marchés. Le Consensus de la Silicon Valley a commencé à être élaboré dans les années 90 et s’est cristallisé dans les années 2000 lorsque le néolibéralisme était en difficulté. Les années 90 ont été une décennie de crise financière. On disait alors qu’il ne suffisait pas de prétendre que le marché fonctionnait spontanément. La couche ajoutée par le Consensus de la Silicon Valley stipule que vous devez encourager les innovateurs, vous devez soutenir les entrepreneurs. Et pour ce faire, il est nécessaire de permettre aux marchés de fonctionner plus librement tout en protégeant les intérêts des innovateurs et des créateurs d’entreprises. Des mesures très dures ont été immédiatement adoptées pour protéger les plus-values, toujours avec cette logique : protéger et inciter à favoriser l’innovation.
Le consensus de la Silicon Valley ajoute une couche supplémentaire au consensus de Washington. La grande justification du consensus de Washington était de dire que la planification ne fonctionnait plus parce que l’Union soviétique avait échoué. Par conséquent, il faut libérer les marchés. Le Consensus de la Silicon Valley a commencé à être élaboré dans les années 90 et s’est cristallisé dans les années 2000 lorsque le néolibéralisme était en difficulté. Les années 90 ont été une décennie de crise financière. On disait alors qu’il ne suffisait pas de prétendre que le marché fonctionnait spontanément. La couche ajoutée par le Consensus de la Silicon Valley stipule que vous devez encourager les innovateurs, vous devez soutenir les entrepreneurs. Et pour ce faire, il est nécessaire de permettre aux marchés de fonctionner plus librement tout en protégeant les intérêts des innovateurs et des créateurs d’entreprises. Des mesures très dures ont été immédiatement adoptées pour protéger les plus-values, toujours avec cette logique : protéger et inciter à favoriser l’innovation.
Tout cela s’est reflété dans une sauce d’idées des années 70 et mélangée ensuite avec beaucoup d’opportunisme pour conduire à ce que vous définissez comme un monde auquel nous ne pouvons pas échapper.
![]() Il y a eu, au départ, une réappropriation de l’idéologie californienne, idéologie pro-technique et pro-individuelle. Cette idéologie californienne a facilité la rhétorique qui soutiendra plus tard les lignes directrices du Consensus de la Silicon Valley. Et en ce qui concerne ce monde qui nous entoure, eh bien, c’est le monde où règne le Big Data, qui finit par nous connaître mieux que nous-mêmes. La logique de la surveillance finit par transcender les individus et en elle, il y a comme une impasse. Nous ne pouvons pas échapper à ce monde parce que, individuellement, nous sommes plus faibles que les algorithmes. Nous sommes dominés et guidés par eux. Il n’existe pas de solution individuelle pour la protection des individus contre les supports numériques. Au contraire, nous devons réfléchir à la manière dont, collectivement, nous pouvons nous émanciper d’eux, en préservant des espaces d’existence qui ne sont pas totalement dominés par ce système. C’est une discussion politique et non technologique.
Il y a eu, au départ, une réappropriation de l’idéologie californienne, idéologie pro-technique et pro-individuelle. Cette idéologie californienne a facilité la rhétorique qui soutiendra plus tard les lignes directrices du Consensus de la Silicon Valley. Et en ce qui concerne ce monde qui nous entoure, eh bien, c’est le monde où règne le Big Data, qui finit par nous connaître mieux que nous-mêmes. La logique de la surveillance finit par transcender les individus et en elle, il y a comme une impasse. Nous ne pouvons pas échapper à ce monde parce que, individuellement, nous sommes plus faibles que les algorithmes. Nous sommes dominés et guidés par eux. Il n’existe pas de solution individuelle pour la protection des individus contre les supports numériques. Au contraire, nous devons réfléchir à la manière dont, collectivement, nous pouvons nous émanciper d’eux, en préservant des espaces d’existence qui ne sont pas totalement dominés par ce système. C’est une discussion politique et non technologique.
Tout est exactement l’inverse dans cet univers numérique. Le moderne s’habille en féodal, même l’apparente horizontalité se transforme en un abîme vertical où règnent inégalités et injustices sociales et l’initiative personnelle tant promue devient un monopole effrayant.
![]() Ce que nous observons, c’est que nous sommes dans un moment de re-monopolisation. En fin de compte, les médias numériques étaient censés réduire les coûts et donc faciliter la concurrence, mais c’est le contraire qui s’est produit. Un mouvement de monopolisation très puissant est arrivé. Les plates-formes contrôlent tout et quand quelque chose est hors de leur contrôle, elles achètent aux entreprises qui leur font concurrence. Elles monopolisent tout. Ce phénomène de concentration conduit les structures économiques à se durcir, à être plus rigides au lieu de les aérer comme le propose la promesse initiale. Cela a des conséquences très importantes dans le domaine des inégalités économiques. Les grandes citadelles numériques sont capables de concentrer des volumes de profits considérables. Ces bénéfices sont redistribués d’abord aux actionnaires, puis à une couche d’employés. Ce que nous voyons dans cette économie numérique façonnée par le néolibéralisme, c’est une augmentation des inégalités. Loin d’être un monde d’opportunités, c’est un monde où, enfin, les polarisations se sont accentuées.
Ce que nous observons, c’est que nous sommes dans un moment de re-monopolisation. En fin de compte, les médias numériques étaient censés réduire les coûts et donc faciliter la concurrence, mais c’est le contraire qui s’est produit. Un mouvement de monopolisation très puissant est arrivé. Les plates-formes contrôlent tout et quand quelque chose est hors de leur contrôle, elles achètent aux entreprises qui leur font concurrence. Elles monopolisent tout. Ce phénomène de concentration conduit les structures économiques à se durcir, à être plus rigides au lieu de les aérer comme le propose la promesse initiale. Cela a des conséquences très importantes dans le domaine des inégalités économiques. Les grandes citadelles numériques sont capables de concentrer des volumes de profits considérables. Ces bénéfices sont redistribués d’abord aux actionnaires, puis à une couche d’employés. Ce que nous voyons dans cette économie numérique façonnée par le néolibéralisme, c’est une augmentation des inégalités. Loin d’être un monde d’opportunités, c’est un monde où, enfin, les polarisations se sont accentuées.
Le vol de données, l’espionnage et le traitement ultérieur par des algorithmes sont déjà bien prouvés. Vous ajoutez une idée à ce pillage planétaire : en extrayant nos données, ils capturent notre potentiel social.
![]() Il y a une tendance à penser que ce que font les entreprises, c’est prendre nos données personnelles, individuellement. Cependant, nos données personnelles, en tant que telles, isolées, manquent de valeur et d’utilité. Au lieu de cela, ces données sont utiles et deviennent une force par rapport aux données des autres. Dans cette comparaison, dans ce croisement de données, apparaissent des caractéristiques qui font de nous des êtres humains en société. En tant qu’individus, nous sommes régis par des règles similaires. En fin de compte, ce que fait le Big Data c’est révéler ce pouvoir social. Ce pouvoir nous est inaccessible individuellement, mais il devient visible lorsque l’ensemble des comportements des individus peut être observé et comparé. Le Big Data révèle autre chose qui va au-delà de ce que chacun de nous est capable de voir, et qui nous est rendu sous forme de profils à travers lesquels les comportements sont modifiés. Google ou Netflix peuvent ainsi nous guider selon nos tendances. Mais en faisant cela, ce qu’ils font, c’est nous transmettre quelque chose qu’ils ont appris de la communauté dans son ensemble. C’est précisément cette capacité à nous transmettre, à nous renvoyer, les informations de la communauté d’individus qui est à la base du principe de dépendance que j’ai évoqué il y a un instant.
Il y a une tendance à penser que ce que font les entreprises, c’est prendre nos données personnelles, individuellement. Cependant, nos données personnelles, en tant que telles, isolées, manquent de valeur et d’utilité. Au lieu de cela, ces données sont utiles et deviennent une force par rapport aux données des autres. Dans cette comparaison, dans ce croisement de données, apparaissent des caractéristiques qui font de nous des êtres humains en société. En tant qu’individus, nous sommes régis par des règles similaires. En fin de compte, ce que fait le Big Data c’est révéler ce pouvoir social. Ce pouvoir nous est inaccessible individuellement, mais il devient visible lorsque l’ensemble des comportements des individus peut être observé et comparé. Le Big Data révèle autre chose qui va au-delà de ce que chacun de nous est capable de voir, et qui nous est rendu sous forme de profils à travers lesquels les comportements sont modifiés. Google ou Netflix peuvent ainsi nous guider selon nos tendances. Mais en faisant cela, ce qu’ils font, c’est nous transmettre quelque chose qu’ils ont appris de la communauté dans son ensemble. C’est précisément cette capacité à nous transmettre, à nous renvoyer, les informations de la communauté d’individus qui est à la base du principe de dépendance que j’ai évoqué il y a un instant.
Nous sommes au cœur de ce que vous avez conceptualisé comme « la rente de l’immatériel ».
![]() Le revenu de l’immatériel signifie que si nous sommes capables de contrôler ces éléments, nous pourrons également obtenir des avantages économiques, quel que soit l’effort productif qui a été fait. C’est la définition même de la rente, c’est-à-dire obtenir des profits sans efforts productifs. Les immatériels sont des actifs tels que les bases de données, les marques, les méthodes d’organisation, c’est-à-dire tout ce qui peut être répété sans fin sans frais. Les matériels, par exemple, sont des outils, des machines, etc. Les productions d’aujourd’hui sont un mélange de tangible et d’intangible. Cependant, si l’on sépare les propriétaires du tangible des propriétaires de l’immatériel, on constate immédiatement que lorsque la production augmente davantage, les gains de l’immatériel seront toujours plus déconnectés du tangible. Les propriétaires de l’immatériel font un premier effort, mais ensuite leurs bénéfices augmentent indépendamment et sans effort supplémentaire. Au contraire, les propriétaires du tangible devront continuer à faire des efforts. Dans l’économie numérique, l’accumulation des bénéfices favorise les actifs incorporels.
Le revenu de l’immatériel signifie que si nous sommes capables de contrôler ces éléments, nous pourrons également obtenir des avantages économiques, quel que soit l’effort productif qui a été fait. C’est la définition même de la rente, c’est-à-dire obtenir des profits sans efforts productifs. Les immatériels sont des actifs tels que les bases de données, les marques, les méthodes d’organisation, c’est-à-dire tout ce qui peut être répété sans fin sans frais. Les matériels, par exemple, sont des outils, des machines, etc. Les productions d’aujourd’hui sont un mélange de tangible et d’intangible. Cependant, si l’on sépare les propriétaires du tangible des propriétaires de l’immatériel, on constate immédiatement que lorsque la production augmente davantage, les gains de l’immatériel seront toujours plus déconnectés du tangible. Les propriétaires de l’immatériel font un premier effort, mais ensuite leurs bénéfices augmentent indépendamment et sans effort supplémentaire. Au contraire, les propriétaires du tangible devront continuer à faire des efforts. Dans l’économie numérique, l’accumulation des bénéfices favorise les actifs incorporels.
Aujourd’hui, de vastes domaines du tangible persistent, nous sommes donc, au moment où vous écrivez, sur la voie vers un féodalisme moderne.
![]() Petit à petit, nous nous dirigeons de plus en plus vers ce féodalisme. Ce n’est pas encore une forme complète, il y a encore des secteurs et des espaces sociaux qui échappent à cette logique, mais la logique du techno-féodalisme a une ascension continue au fil de nos vies. Curieusement, ce que j’essaie de dire, et c’est paradoxal, c’est qu’il y a une victoire paradoxale pour Marx. Le marxisme a parié que le développement des forces productives, le processus de modernisation, conduiraient à une socialisation très importante. Nous allions toujours nous soutenir les uns aux autres. Et avec l’histoire numérique, quelque chose comme ça se produit. Les espaces numériques nous connectent les uns aux autres et nous rendent dépendants des autres à un degré jamais atteint auparavant. La densité des liens des individus avec la communauté est très forte. Mais cela n’est pas incarné de la manière optimiste que pensaient Marx et le marxisme. La figure de l’écrasement a été imposée. Enfin, il existe un nombre très limité d’individus capables de diriger et de contrôler ce processus de socialisation pour maintenir leur position dominante. La figure de l’écrasement et de la centralisation à travers les espaces numériques nous conduit à l’opposé de toute perspective d’émancipation. Il y a quelque chose de très menaçant dans tout cela. Ne le sous-estimez pas. C’est une bataille qui commence. Il appartient aux forces émancipatrices d’imaginer différentes formes de socialisation.
Petit à petit, nous nous dirigeons de plus en plus vers ce féodalisme. Ce n’est pas encore une forme complète, il y a encore des secteurs et des espaces sociaux qui échappent à cette logique, mais la logique du techno-féodalisme a une ascension continue au fil de nos vies. Curieusement, ce que j’essaie de dire, et c’est paradoxal, c’est qu’il y a une victoire paradoxale pour Marx. Le marxisme a parié que le développement des forces productives, le processus de modernisation, conduiraient à une socialisation très importante. Nous allions toujours nous soutenir les uns aux autres. Et avec l’histoire numérique, quelque chose comme ça se produit. Les espaces numériques nous connectent les uns aux autres et nous rendent dépendants des autres à un degré jamais atteint auparavant. La densité des liens des individus avec la communauté est très forte. Mais cela n’est pas incarné de la manière optimiste que pensaient Marx et le marxisme. La figure de l’écrasement a été imposée. Enfin, il existe un nombre très limité d’individus capables de diriger et de contrôler ce processus de socialisation pour maintenir leur position dominante. La figure de l’écrasement et de la centralisation à travers les espaces numériques nous conduit à l’opposé de toute perspective d’émancipation. Il y a quelque chose de très menaçant dans tout cela. Ne le sous-estimez pas. C’est une bataille qui commence. Il appartient aux forces émancipatrices d’imaginer différentes formes de socialisation.
Mais comment y arriver si on est aussi dans le paradoxe de l’obéissance ?
![]() Ce qui ne colle pas, c’est l’idée qu’il existe une solution individuelle à ce mouvement. Maintenant, les gens ne sont pas innocents. Il y a une préoccupation qui devient de plus en plus visible. L’enjeu est de trouver des solutions qui passent par des interventions politiques qui soumettent le fonctionnement de ces plateformes à la logique des services publics. Il faut aller vers cela. Les plates-formes jouent aujourd’hui un rôle politique énorme. Cependant, un principe d’autonomie politique persiste.
Ce qui ne colle pas, c’est l’idée qu’il existe une solution individuelle à ce mouvement. Maintenant, les gens ne sont pas innocents. Il y a une préoccupation qui devient de plus en plus visible. L’enjeu est de trouver des solutions qui passent par des interventions politiques qui soumettent le fonctionnement de ces plateformes à la logique des services publics. Il faut aller vers cela. Les plates-formes jouent aujourd’hui un rôle politique énorme. Cependant, un principe d’autonomie politique persiste.
Página12. Buenos Aires, le 24 janvier 2020.
*Eduardo Febbro. Correspondant du quotidien argentin Página 12 efebbro@pagina12.com.ar et journaliste de RFI à Paris.
Traduit de l’espagnol pour El Correo de la Diáspora par : Estelle et Carlos Debiasi
Del mismo autor
- « Techno-féodalisme, critique de l’économie numérique » 26/01/2021
- “Tecno-Feudalismo, crítica de la economía digital” 26/01/2021
- El mundo después del coronavirus: "El impulso es hacia un sistema postcapitalista" 11/05/2020
- “Os evangélicos no Brasil ocuparam o espaço do Estado” 17/10/2018
- França: um exemplo do poder destruidor que podem ter as redes sociais 31/01/2014
- Leonardo Boff analisa primeiro ano do Papa Francisco 13/12/2013
- Jacques Henno: "Estamos todos vigilados y fichados" 12/09/2013
- Jacques Henno: ‘Estamos todos vigiados e fichados’ 12/09/2013
- Papa Francisco deve anunciar "evangelho social" no Brasil 21/07/2013
- As redes de espionagem secreta das democracias ocidentais 06/07/2013
Clasificado en
Internet ciudadana
- Nick Bernards 31/03/2022
- Paola Ricaurte 10/03/2022
- Burcu Kilic 03/03/2022
- Shreeja Sen 25/02/2022
- Internet Ciudadana 16/02/2022