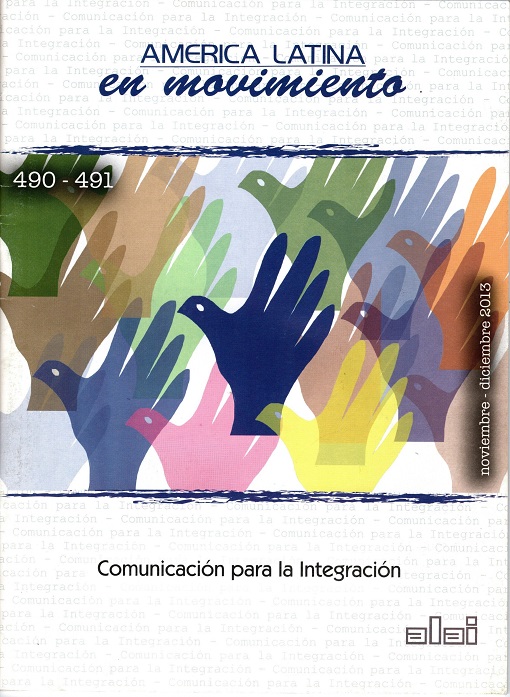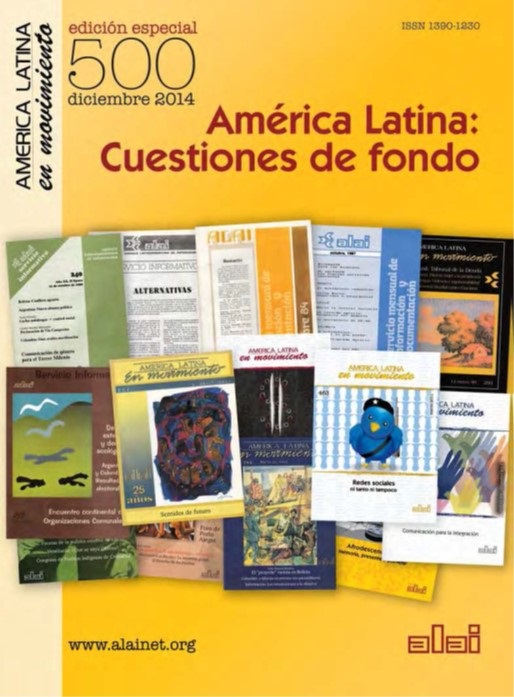Derrière le refus allemand d’accorder l’allégement de la dette de la Grèce
- Opinión
Le drame financier de la Grèce a dominé les titres depuis cinq ans pour une raison : le refus entêté de nos créanciers de permettre un allégement indispensable de la dette. Mais contre le sens commun, contre le verdict du FMI et contre les pratiques quotidiennes des banquiers face à des débiteurs stressés, pourquoi résistent-ils à une restructuration de la dette ? La réponse ne peut pas être trouvée dans l’économie parce qu’elle réside au fond dans le labyrinthe politique de l’Europe.
En 2010, l’état grec est devenu insolvable. Deux options cohérentes avec l’adhésion dans la zone euro se sont présentées : la raisonnable, que tout banquier décent recommanderait – la restructuration de la dette et réformer l’économie ; et l’option toxique – l’extension de nouveaux prêts à une entité ruinée en faisant semblant qu’elle demeure solvable.
L’Europe officielle a choisi la deuxième option, mettant en liberté provisoire des banques françaises et allemandes exposées à la dette publique grecque au-delà de la viabilité socio-économique de la Grèce. Une restructuration de dette aurait impliqué des pertes pour les banquiers sur leurs titres de dette grecque. Prompts à éviter d’avouer aux parlements que les contribuables devraient payer de nouveau pour les banques au moyen de nouveaux prêts pas soutenables , les fonctionnaires d’UE ont présenté l’insolvabilité de l’état grec comme un problème de liquidités et ont justifié le « plan de sauvetage » comme un cas de « solidarité » avec les Grecs.
Pour encadrer le transfert cynique des pertes privées irrémédiables sur les épaules des contribuables comme un exercice "de qui aime bien châtie bien », une austérité record a été imposée à la Grèce, dont le revenu national, en retour – à partir duquel les nouvelles et vieilles dettes devaient être remboursées – a diminué de plus d’un quart. Il suffit de l’expertise mathématique de quelqu’un d’intelligent âgé de huit pour savoir que ce processus ne pouvait pas se terminer bien.
Une fois que l’opération sordide fut achevée, l’Europe avait acquis automatiquement une autre raison pour refuser de discuter la restructuration de la dette : elle frapperait maintenant les poches des citoyens européens ! Et ainsi des doses plus importantes d’austérité ont été administrées alors que la dette devenait plus lourde, forçant les créanciers à étendre les prêts en échange d’encore plus d’austérité.
Notre gouvernement a été élu sur un mandat pour mettre fin à cette spirale de la mort ; pour demander la restructuration de la dette et la fin de cette austérité écrasante. Les négociations ont atteint leur impasse la plus médiatique pour une raison simple : nos créanciers continuent à exclure toute restructuration tangible de la dette, tout en exigeant que notre dette impayable soit remboursée « paramétriquement » par les plus faibles des Grecs, leurs enfants et leurs petits-enfants.
Durant ma première semaine comme ministre des finances j’ai reçu la visite par Jeroen Dijsselbloem, président de l’Eurogroupe (les ministres des Finances de la zone euro), qui m’a proposé un choix brutal : acceptez « la logique » du plan de sauvetage et laissez tomber toute demande de restructuration de la dette ou votre demande de prêt « s’écroulera » – la répercussion non dite étant que les banques de la Grèce s’effondreraient.
Cinq mois de négociations s’en sont suivis sous des conditions d’asphyxie monétaire et de la menace induite d’une panique bancaire dominée et administrée par la Banque centrale européenne. C’était écrit sur le mur : à moins que nous capitulions, nous ferions face aux contrôles des capitaux, aux distributeurs de billets, à un bank holiday prolongé et, finalement, le Grexit.
La menace de Grexit a eu des hauts et des bas dans l’histoire. En 2010, elle a mis une peur de tous les diables dans le cœur et l’esprit des financiers puisque leurs banques étaient bourrées de dette grecque. Même en 2012, quand le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, a décidé que le prix du Grexit était un « investissement » intéressant comme façon de discipliner la France , cette perspective a continué à flanquer une trouille bleue à presque tout le monde.
Alors que Syriza est arrivé au pouvoir en janvier dernier et comme pour confirmer notre revendication que les « sauvetages » n’avaient rien à voir avec le fait de sauver la Grèce (et tout à voir le ring fencing (NDT préserver les activités de banque commerciale des fluctuations de marchés et des risques financiers spécifiques aux banques d’investissement) de l’Europe septentrionale), une grande majorité dans l’Eurogroupe – sous la tutelle de Schäuble – avait adopté le Grexit comme sa solution préférée ou comme arme de choix contre notre gouvernement.
Les Grecs, à juste titre, frissonnent à la pensée leur amputation de l’union monétaire. Sortir de la monnaie commune n’est rien de plus qu’arracher une patère, comme la Grande-Bretagne l’a fait en 1992, quand Norman Lamont l’a célébrèrent annoncé le matin où la sterling a quitté le mécanisme de taux de change (ERM) européen. Hélas, la Grèce n’a pas de devise dont la patère avec l’euro peut être cassée. Elle a l’euro – une devise étrangère complètement administrée par un créancier hostile à la restructuration de la dette non viable de notre nation.
Pour sortir, nous devrions créer une nouvelle devise de la cassure. Dans l’Irak occupé, l’introduction d’un nouveau papier-monnaie a pris presque une année, environ 20 Boeing 747s, la mobilisation de la puissance des militaires américains, trois sociétés d’imprimerie et des centaines de camions. Faute d’un tel soutien, le Grexit serait l’équivalent de l’annonce d’une grande dévaluation plus de 18 mois à l’avance : une recette pour liquider tout le stock de capital grec et le transférer à l’étranger par tous les moyens disponibles.
Avec le Grexit renforçant la faillite bancaire initiée par la banque centrale européenne-, nos tentatives de remettre la restructuration de dette sur la table de négociation sont tombées dans de sourdes oreilles. Maintes et maintes fois on nous a dit que c’était une affaire pour un futur non défini qui suivrait l’achèvement réussi du « programme » – une Prise prodigieuse 22 depuis que le « programme » ne pourrait jamais réussir sans une restructuration de dette.
Ce week-end apporte le point culminant des pourparlers puisque Euclid Tsakalotos, mon successeur, s’efforce, de nouveau, de mettre le bœuf avant la charrue – pour convaincre un Eurogroupe hostile que la restructuration de dettes est un préalable pour réussir à réformer la Grèce, pas une récompense ex-post pour elle. Pourquoi est-il si difficile d’y parvenir ? Je vois trois raisons.
L’Europe ne savait pas comment répondre à la crise financière.
Devrait-elle se préparer à une expulsion (Grexit) ou à une fédération ?
Tout d’abord, c’ est cette inertie institutionnelle difficile à battre. Deuxièmement, que la dette insoutenable donne un pouvoir immense aux créanciers sur les débiteurs – et le pouvoir, comme nous savons, corrompt même le plus parfait. Mais c’est le troisième qui me semble plus pertinent et, effectivement, plus intéressant.
L’euro est un hybride d’un régime de taux de change fixé, comme les années 1980 l’ ERM, ou l’étalon or des années 1930, et d’une devise d’Etat. Ce dernier repose sur la peur de l’expulsion pour rester uni, pendant que l’argent public implique des mécanismes pour recycler des surplus entre les Etats membres (par exemple, un budget fédéral, des obligations communes). La zone euro tombe entre ces écueils – c’est plus qu’un régime de taux de change et moins qu’un régime d’état.
Et il y a le fait de s’y faire. Après la crise de 2008/9, l’Europe ne savait pas comment répondre. Devrait-elle préparer le terrain pour au moins une expulsion (c’est-à-dire le Grexit) pour renforcer la discipline ? Ou évoluer vers une fédération ? Jusqu’à présent elle n’a rien fait, son angoisse d’existentialiste progresse pour toujours. Schäuble est convaincu que puisque les choses sont ainsi, il a besoin du Grexit pour clarifier l’air, d’une manière ou d’une autre. Subitement, l’insoutenable dette publique grecque sans laquelle le risque de Grexit se fanerait, a acquis une nouvelle utilité pour Schauble. »
Que veux-je dire par cela ? Basée sur les mois de négociation, ma conviction est que le ministre des Finances allemand veut que la Grèce soit évincée de la monnaie unique pour faire naitre une crainte de tous les diables chez les Français et leur faire accepter son modèle d’une zone euro disciplinaire.
Athènes, 11 juillet 2015
* Yánis Varoufákis est économiste, professeur à Cambridge, à Sidney, Glasgow et Louvain. et homme politique grec. Députe et ex-Ministre de l’économie du Gouvernement Syriza.
Original : « Behind Germany’s refusal to grant Greece debt relief »
(Traduit de l’anglais pour El Correo par : Estelle et Carlos Debiasi)
Del mismo autor
- O tecno-feudalismo está tomando conta 29/06/2021
- A verdade após Trump 02/02/2021
- O capitalismo não está funcionando - eis aqui uma alternativa 17/09/2020
- Uma crônica prenunciada de uma década perdida 29/05/2020
- Last night Julian Assange called me. Here is what we talked about 25/03/2020
- Por que Marx, no século 21? 07/05/2018
- O alto preço de negar a luta de classes 19/12/2017
- Democracy, power and sovereignty in today’s Europe 21/01/2016
- Derrière le refus allemand d’accorder l’allégement de la dette de la Grèce 13/07/2015
- Behind Germany’s refusal to grant Greece debt relief 13/07/2015
Clasificado en
Clasificado en:
Crisis Económica
- Geraldina Colotti 07/04/2022
- Julio C. Gambina 07/04/2022
- Rafael Bautista S. 06/04/2022
- Julio Gambina 04/04/2022
- José Ramón Cabañas Rodríguez 01/04/2022