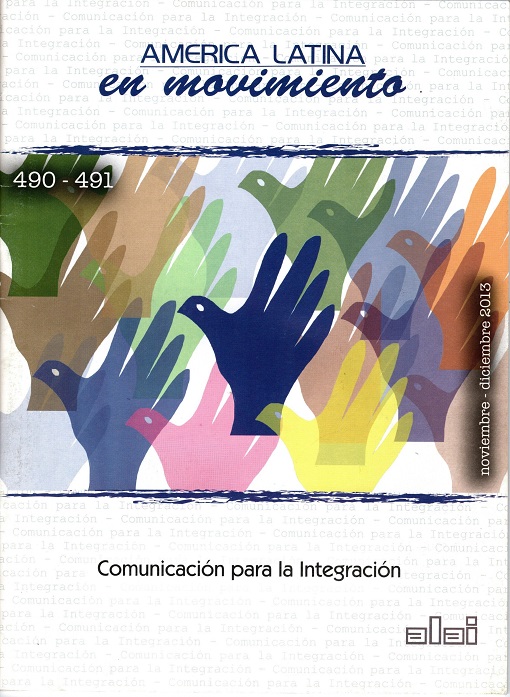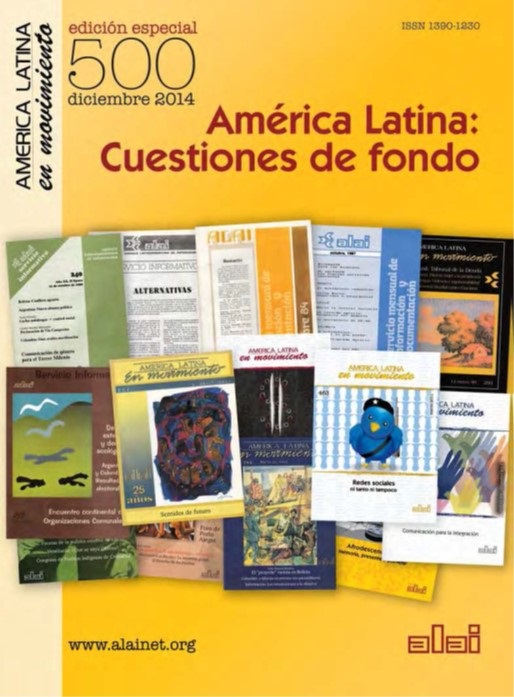La révolution brésilienne
01/08/2002
- Opinión
Le mot révolution flotte dans les limbes du discours politique. Non
obstant, il faut le ramener dans le monde d’ici-bas pour donner sens à la
situation brésilienne actuelle en ces temps d’élections. Nous entendons
le terme révolution au sens que lui a conféré Caio Prado Jr. dans son
classique Revoluçáo brasileira (1966), définition qui laisse loin
derrière l’idée conventionnelle qui associe révolution avec violence :
« des transformations capables de restructurer la vie du Brésil en
adéquation avec ses besoins les plus généraux et les plus profonds, et
avec les aspirations de la majorité de sa population qui, en l’état
actuel, ne sont pas réellement prises en compte... quelquechose qui fasse
prendre à la vie du pays un nouveau cap ». Passons en revue quelques
données qui appellent une restructuration sociale du Brésil :
En premier lieu, le fait honteux de ce qu’un tiers de la population se
situe au-dessous du seuil de pauvreté dans un pays qui est l’un des plus
grands exportateurs de grains. Cette donnée macroscopique justifie à elle
seule une révolution.
En deuxième lieu, l’inégalité qui hurle à la mort comme un chien. Les
chiffres de 1999 montrent que 400.000 familles, soit 1 % de la
population, détiennent 53 % de la richesse nationale. Cette minorité ne
manifeste aucune humanité vis-à-vis des 39,6 millions d’autres familles.
Plus que brésilienne, cette minorité se sent transnationale. Au dehors,
dans les hôtels cinq étoiles, elle a honte d’être brésilienne.
En troisième lieu, la dette externe, impossible à rembourser, toujours et
encore renégociée comme actuellement. Pour répondre de cette dette, le
Gouvernement doit se soumettre aux dispositions du FMI. Dans le cas
contraire, il ne reçoit pas de capitaux externes pour solder ses comptes
(23.000 millions en 2001). En 2001, le service de cette dette a soustrait
aux coffres de l’Etat presque 106.900 millions de reales. Autrement dit,
cela équivaut à retirer 203.000 reales à la minute, 24 heures sur 24, 365
jours par an. De ces 106.900 millions de reales, seulement 44.000
millions sont à nous, résultat de l’augmentation des impôts et des coupes
réalisées dans les budgets sociaux. Les 62.900 millions de reales
restants proviennent d’un nouveau prêt externe. De telles distorsions ne
nécessitent-elles pas un changement d’orientation ?
En quatrième lieu, le coût social du Plan Real. Ce plan maintient la
stabilité de la monnaie en contrôlant l’inflation, mais au prix d’un coût
social élevé du fait des hausses d’impôts qui freinent la croissance
économique en gelant les salaires. Le nombre d’exclus est croissant.
Dans les élections actuelles, deux projets s’affrontent : le premier veut
poursuivre la modernisation conservatrice (parce qu’elle n’est pas
sociale), par l’intégration dans la globalisation, en tolérant les
contradictions mais avec la conviction d’un avenir radieux pour tous ; le
second souhaite un changement de cap (son aspect révolutionnaire) en
fondant un nouveau pacte social qui tienne compte des dettes sociales
oubliées, avec la conviction que des changements structurels sont
possibles avec la démocratie.
Le second projet est en train de recevoir la préférence de l’électorat.
La réaction des tenants de la continuité est d’ériger un blindage
politique autour du projet de modernisation conservatrice. Ils le font en
obligeant l’éventuel vainqueur à se déclarer fidèle aux engagements
internationaux et à respecter les règles du jeu actuelles de l’économie
pour qu’elle ne soit pas substantiellement transformée. Mais la
révolution est nécessaire et les forces existent pour qu’elle advienne.
Il faut la vouloir résolument.
Force sociale et politique
La révolution brésilienne est juste une appellation. Elle n’a jamais eu
lieu. Les élites dirigentes vivent dans l’illusion qu’elle n’est pas
nécessaire ; qu’il suffit de faire quelques retouches et, dans les
périodes de crise, de demander plus d’argent au FMI. Et alors le Brésil
recommence à fonctionner sur des bases solides (pour elles). Si les prêts
résolvaient les problèmes sociaux, nous serions tous au paradis social.
Mais ils ne font que nous précipiter encore plus profondément dans le
purgatoire de la dépendance, purgatoire qui se transforme en enfer pour
quelques cinquante millions de brésiliens. Quand Bethino, rempli de
compassion, lançait en 1993 la campagne contre la faim et la misère, il y
avait, selon les données du gouvernement, 32 millions d’affamés. Huit ans
après, en 2001, ils sont 50 millions, selon la Fondation Getúlio Vargas.
Ce chiffre n’est-il pas révélateur d’un enfer ?
Le bon Pape, Jean XXIII, dit à plusieurs reprises que la seule idée des
affamés du monde l’empêchait de dormir. C’est inspiré par ce sentiment
qu’il écrivit l’encyclique Pacem in Terris (1963). Aujourd’hui, en 2002,
le Programme des Nations Unies pour le Développement nous fait honte en
constatant que le Brésil a augmenté le fossé entre ceux qui mangent et
ceux qui ne mangent pas. Bien sûr, nous avons la troisième plus grande
concentration de revenus du monde, derrière la Sierra Leone et le
Suaziland en Afrique. En conséquence de quoi, les droits sont
systématiquement violés. Selon la même source, sur une échelle de 1 à 7
concernant les droits et les libertés, nous avons obtenu la note 3. Nous
dégringolons nettement. Dans ces conditions, on comprend pourquoi notre
démocratie a des bases si limitées. Sur une période de 100 ans, 70 se
sont passés sous les dictatures. L’application des droits et
l’intégration sociale sont des conditions préalables minimums pour le
fonctionnement de la démocratie et pour quelque changement substantiel
que ce soit. Avec un peuple affamé et meurtri, comment ferons-nous le
saut vers une société durable et démocratique ?
Pour tout cela, l’idée gagne du terrain parmi les analystes de ce que la
perversité structurelle brésilienne ne peut être dépassée en faisant
l’économie d’une révolution au sens de changements des structures du
pouvoir social, politique et culturel. Pour une telle révolution, il faut
une accumulation de pouvoir social canalisé en pouvoir politique, qui se
propose de faire la révolution dans le cadre d’une démocratie plus riche.
Cette dernière doit dépasser la simple démocratie électorale, qui
s’arrête à la porte de l’usine, et se présenter comme une démocratie
participative du bas vers le haut et, donc, populaire.
Cette force sociale et politique s’est déjà constituée dans notre pays.
Elle est représentée de façon emblématique par un tour mécanique qui
perce le blindage des élites contre les changements structurels et,
maintenant, pour la quatrième fois, elle se présente comme porteuse de
l’espoir qu’un autre Brésil est possible. Soyons clairs : c’est la seule
qui représente une opposition au système et non une simple opposition au
Gouvernement comme les autres. Son éventuelle victoire pourra signifier
la révolution brésilienne. Mais si, par faiblesse face aux élites, elle
ne la mène pas à bien, elle sera exécrée par la conscience meilleure de
notre peuple. Son but premier est révolutionnaire : Faim Zéro. Qui ne
commence pas par là, trompe 50 millions d’affamés, administre la faim
avec des miettes mais ne s’occupe pas des affamés. Cette fois nous devons
oser une chose que nous n’avons jamais faite. Et l’audace pourra nous
récompenser avec le début de la révolution nécessaire, rêve des meilleurs
d’entre nous.
Politique-chimpanzé
La révolution brésilienne nécessaire ne veut pas seulement refermer la
veine ouverte par laquelle s’écoule le sang de cinquante millions de
brésiliens. Elle veut être le facteur d’une humanisation plus haute. En
un mot : nous faisons l’hypothèse de la révolution parce que nous voulons
faire un pas plus grand vers le règne du spécifiquement humain. En quoi
consiste cet humain ?
Il consiste dans le fait singulier de nous présenter comme des êtres de
socialisation, de coopération et de convivialité. Une telle singularité
ressort mieux lorsque nous nous comparons avec les singes les plus
proches : les chimpanzés. En termes génétiques, nous nous différencions
d’eux d’à peine 1,6 %. Eux aussi ont une vie sociale. Mais ils
s’orientent selon la logique de la domination, de la hiérarchisation et
de la soumission de l’autre. En conséquence, les relations sont peu
coopératives et de domination.
Avec l’arrivée de l’être humain, cette logique est rompue. Nous ne
connaissons pas la date exacte, mais cela fait sûrement autour de trois
millions d’années. A l’inverse de la compétitivité et de l’oppression, la
coopération s’installe. Concrètement, nos ancêtres humanoïdes partaient à
la chasse, ramenaient la nourriture et la répartissaient socialement
entre eux. Ils ne faisaient pas comme les autres primates supérieurs qui
se nourrissent chacun pour soi. Ce 1,6 % d’acides nucléïques et de bases
phosphatées qui lui est propre fonde l’humain en tant qu’humain, comme un
être de coopération. Ces liens de solidarité firent aussi surgir
l’attendrissement et la relation d’attention réciproque. Ce fut cette
relation qui servit de milieu ambiant à l’apparition du langage dans
lequel réside l’essence humaine.
Cette interprétation de l’anthropogénèse est récurrente parmi les grands
noms des sciences de la vie comme les fameux scientifiques chiliens
Humberto Maturana et Francisco Varela ou Frijhof Capra, Christian de
Duve, entre autres. Humberto Maturana résume le tout en disant : « Ce qui
nous fait êtres humains, c’est notre manière particulière de vivre
ensemble comme des êtres sociaux dans le langage ».
La coopération empêche l’accumulation excessive, d’une part, et
l’appauvrissement, de l’autre. Il s’avère qu’aujourd’hui règne un système
qui s’organise, non pas dans l’échange coopératif, mais dans l’échange
compétitif dans lequel seul le plus fort gagne. C’est le capitalisme,
comme mode de production et comme culture, qui représente la survivance
de la politique du chimpanzé en nous, ou, avec les mots de Humberto
Maturana, de cette charge génétique que nous avons en commun avec les
chimpanzés, la part qui n’a pas encore inauguré le règne de l’humain avec
sa force sociale et coopérative. Pour cela, ce système est individualiste
et excluant. Il réaffirme et il magnifie l’individu et le moi au prix du
nous. C’est cette logique qui permet la perversité de 50 millions
d’affamés et d’exclus dans notre pays à côté de 400.000 familles aisées.
Voilà une bonne raison de vouloir la révolution, pour dépasser cette
barbarie, pour pouvoir être plus humains, plus êtres de langage
communicatif, de relation et de solidarité non restrictives.
Dans ce sens, nous sommes encore dans l’antichambre de notre véritable
humanité. Les deux tiers des humains vivent à des niveaux de cruauté sans
pitié, victimes de la voracité accumulatrice de la logique chimpanzé. La
révolution nécessaire aura des raisons éthiques et de compassion avec nos
semblables. Avec eux nous voulons partager le pain, être compagnons (cum
panis) dans l’aventure planétaire.
Traduit du portugais par ALAI.
https://www.alainet.org/es/node/106296
Del mismo autor
- O risco da destruição de nosso futuro 05/04/2022
- Reality can be worse than we think 15/02/2022
- ¿Hay maneras de evitar el fin del mundo? 11/02/2022
- Há maneiras de evitar o fim do mundo? 08/02/2022
- The future of human life on Earth depends on us 17/01/2022
- El futuro de la vida depende de nosotros 17/01/2022
- A humanidade na encruzilhada: a sepultura ou… 14/01/2022
- “The iron cage” of Capital 04/01/2022
- Ante el futuro, desencanto o esperanzar 04/01/2022
- Desencanto face ao futuro e o esperançar 03/01/2022